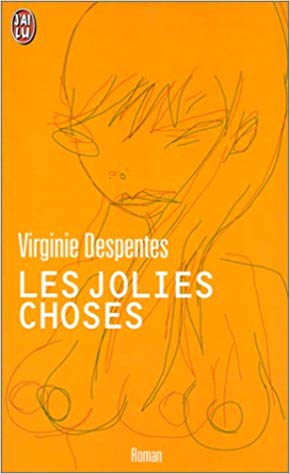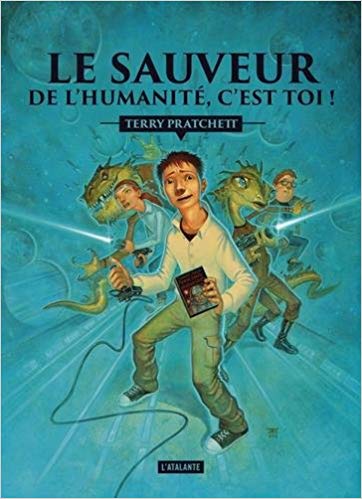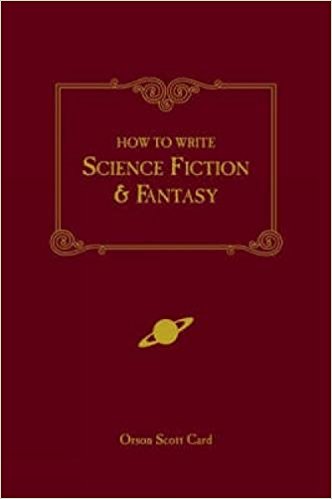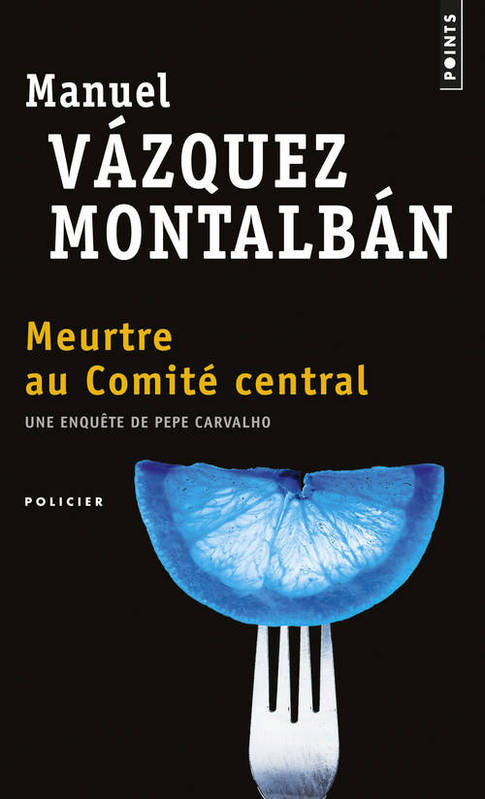Patricia grandit en Angleterre pendant la deuxième guerre mondiale. Faisant des études à Oxford ou bien Cambridge, je ne sais plus, elle est courtisée par Mark, un type un peu fat et un peu froid. Mark la demande en mariage en urgence (et non, ils n’ont pas encore couché ensemble). « C’est maintenant ou jamais ».
Patricia dira-t-elle maintenant ? Ou bien jamais ?
Le roman décide de nous raconter deux vies de Patricia, l’une où elle se marie, l’autre où elle repousse Mark. Deux vies différentes, durant lesquelles Patricia fera des enfants (avec Mark ou sans lui), des choix de vie et de carrière différentes dans des mondes de plus en plus différents.
Mes vraies enfants est une uchronie intime, qui raconte tout autant les deux vies possibles de l’héroïne que les deux mondes possibles dans lesquelles elle vit et qui, SPOILER ALERT !, ne sont le nôtre dans aucun des deux cas.
C’est aussi un beau roman féministe, qui évoque une femme très vraie qui pourrait être la grand-mère de l’autrice, qui parle des joies et des malheurs de la vie de couple et de famille, de la force et des soucis que les enfants apportent à leurs parents.
Là où un écrivain de roman familial aurait tiré trois tomes de ces deux vies entremêlées, Jo Walton nous donne un récit d’écrivain de SF, qui se concentre sur les faits et le world building. C’est un choix littéraire qui rend le roman court et dense (c’est bien) mais qui, je pense, l’affaiblit un peu et en fait une œuvre plutôt théorique. Mais c’est aussi la manière dont les deux vies se mêlent et se percutent qui provoque les effets de sense of wonder du livre. Waow.