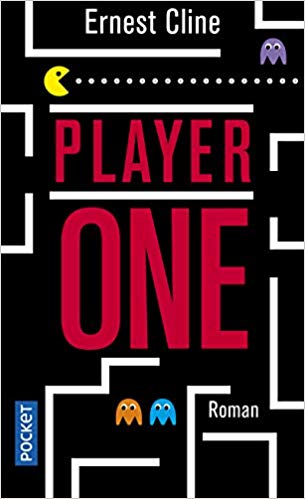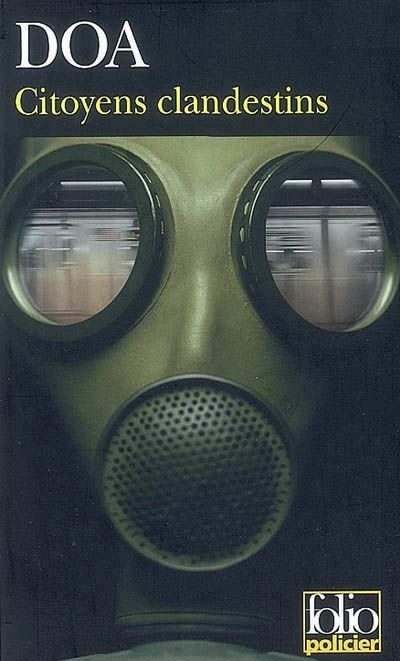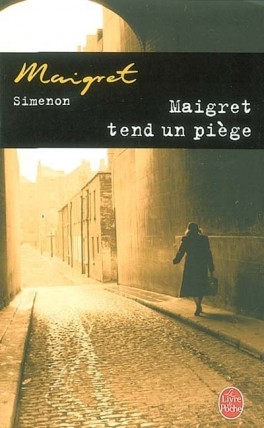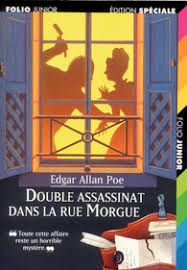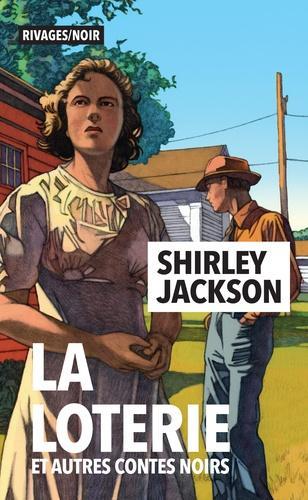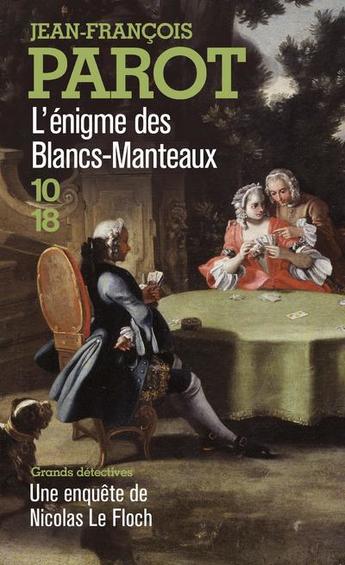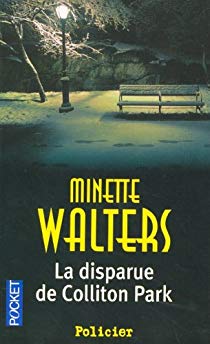Je parle ici du livre, pas du film de Spielberg (pas vu).
Dans un futur déglingué, toute la planète est connectée à l’OASIS, système de réalité virtuelle du feu de Dieu, mélange d’Internet complet de MMORPG multi multi mondes. Le créateur de l’OASIS, Halliday, un génie croisement entre Steve Jobs, Bill Gates et Spielberg et Gygax, vient de mourir en indiquant qu’un Easter Egg était caché dans les milliards de mondes de l’OASIS et que celui qui le trouverait prendrait le contrôle de la société OASIS, et donc du monde… Et pour trouver cet « oeuf », il faut plonger dans l’univers mental années 80 de Halliday, séries télé, films, livres de SF et de Fantasy, musique…
Wade, le héros, est le tout premier a trouver un indice utile dans la quête de l’œuf. Contre lui, des milliers de concurrents et toute la horde des sixers, les méchants chasseurs pros payés par la méchante compagnie de télécom qui veut prendre contrôle de la trop cool OASSIS.
L’idée de base est marrante, pitchable en quelques mots et attirante. Toute la partie hommage aux années 80 est assez réussie, elle permettra aux ados blancs à lunettes des années 80 (donc les gens au pouvoir maintenant, rappelons-le) de reconnaître des signes culturels qui feront tilt.
Après ça, le livre se déroule comme un scénario hyper balisé de jeu vidéo. Il y aura trois clefs, trois portails, des retournements finaux, exactement comme vous pourriez le prévoir.
(au bout de cinquante pages, posez le livre et planifiez le scénario en vous appuyant sur les clichés et les effets les plus attendus : ça va se passer comme ça).
L’auteur s’efforce de décrire la tech et la société du futur, avec des idées marrantes (appareils haptiques, servage pour dettes…) qui malheureusement ne tiennent pas debout. Le côté le plus déplaisant du bouquin étant cette vision du monde de petit garçon qui, si elle est acceptable dans les films des années 80 (les goonies…) parce qu’à l’époque elle illustrait un point de vue original, ne l’est plus maintenant où elle doit au moins être un peu critiquée. L’auteur s’en rend d’ailleurs compte et essaie de corriger le tir, avec maladresse (l’identité de Aech, par exemple).
Un autre truc frappant : l’incapacité de l’auteur à penser le collectif, la société. On est en fait dans ce monde vieillot où le petit garçon héros tout seul surmonte toutes les difficultés…
Quelques livres mieux faits, sur des sujets voisins:
Le sauveur de l’humanité, c’est toi (Terry Pratchett), évoque de bien meilleure manière le jeu vidéo à l’ancienne et comment il permet à un jeune garçon de supporter un monde de merde (la banlieue anglaise des années Thatcher).
Mowenna, de Jo Walton, que j’ai lu à sa sortie et pas chroniqué, un beau portrait de jeune femme à travers ses lectures de SF.
Alors, avec tout le mal que j’en ai dit, Player One est-il bon à jeter ?
Même pas : c’est un bouquin distrayant, l’hommage aux années 80 est assez savant (même s’il ne m’a pas impressionné), et si on veut une histoire tadam ! qui mêle cyberpunk et jeu vidéo, on pourra y trouver un certain plaisir.