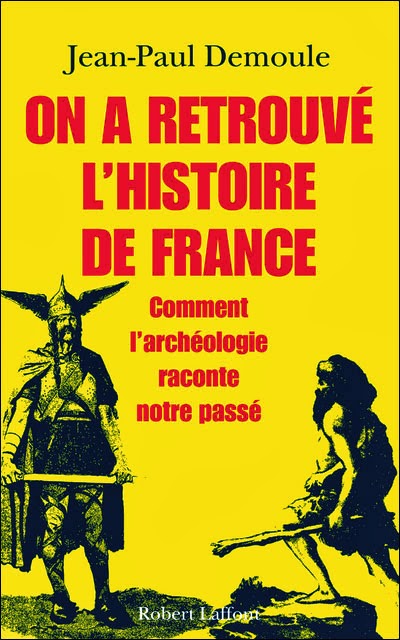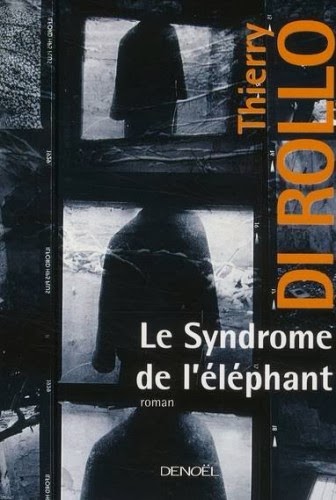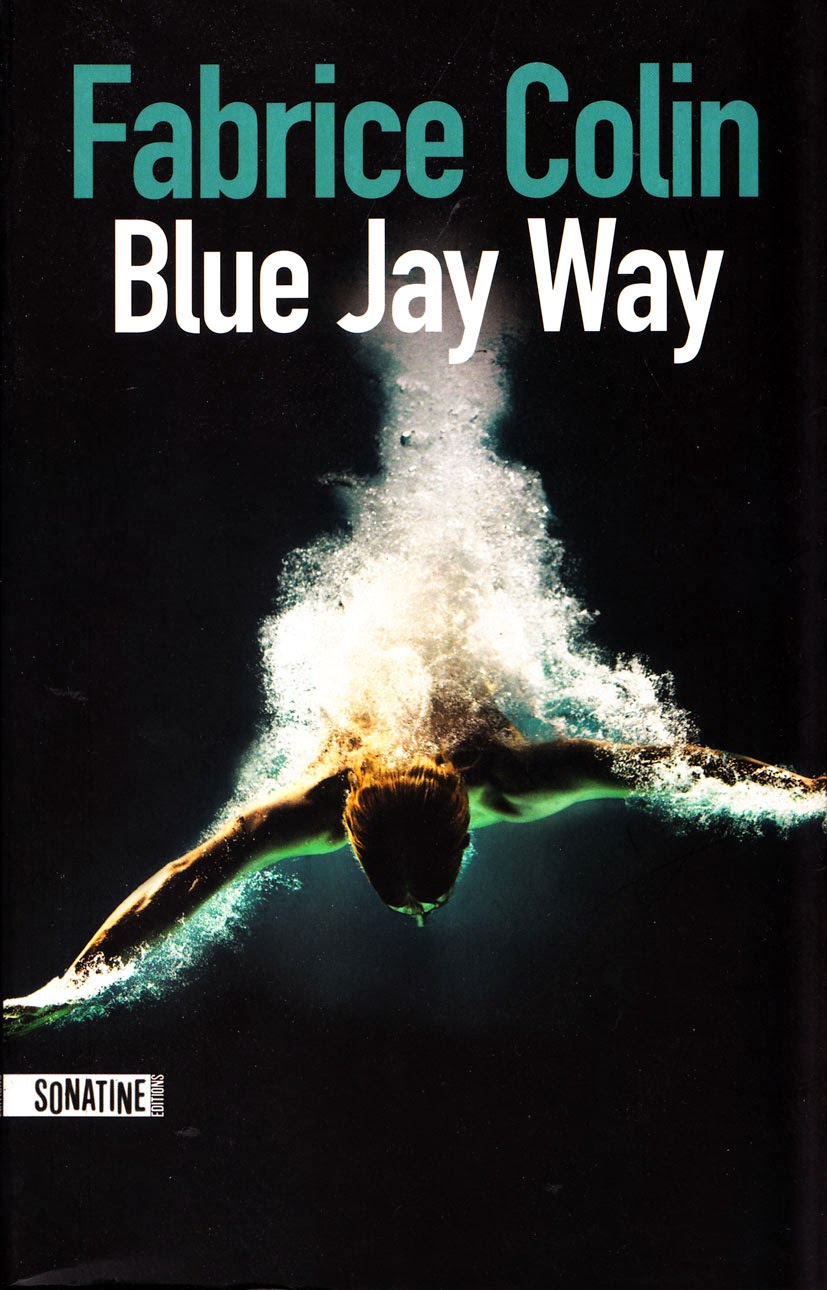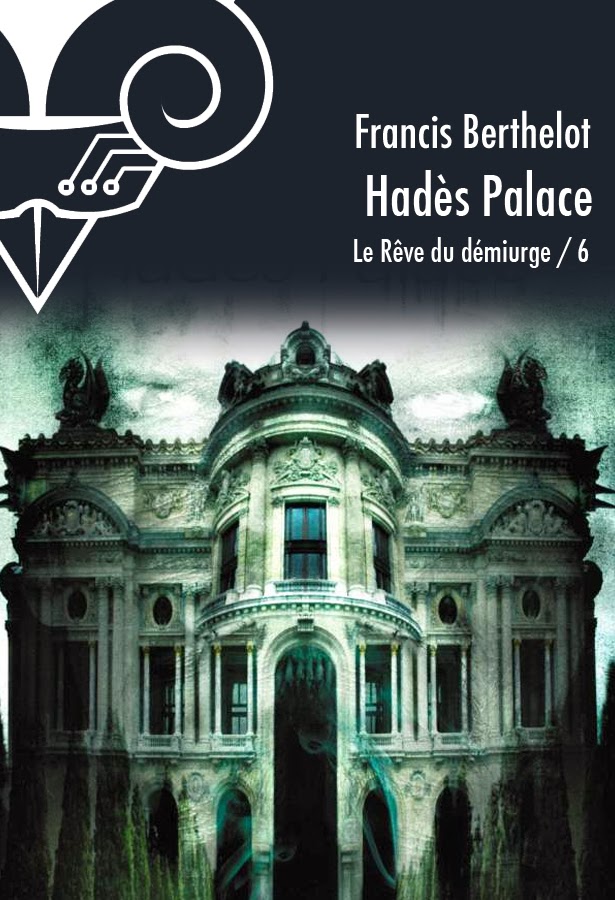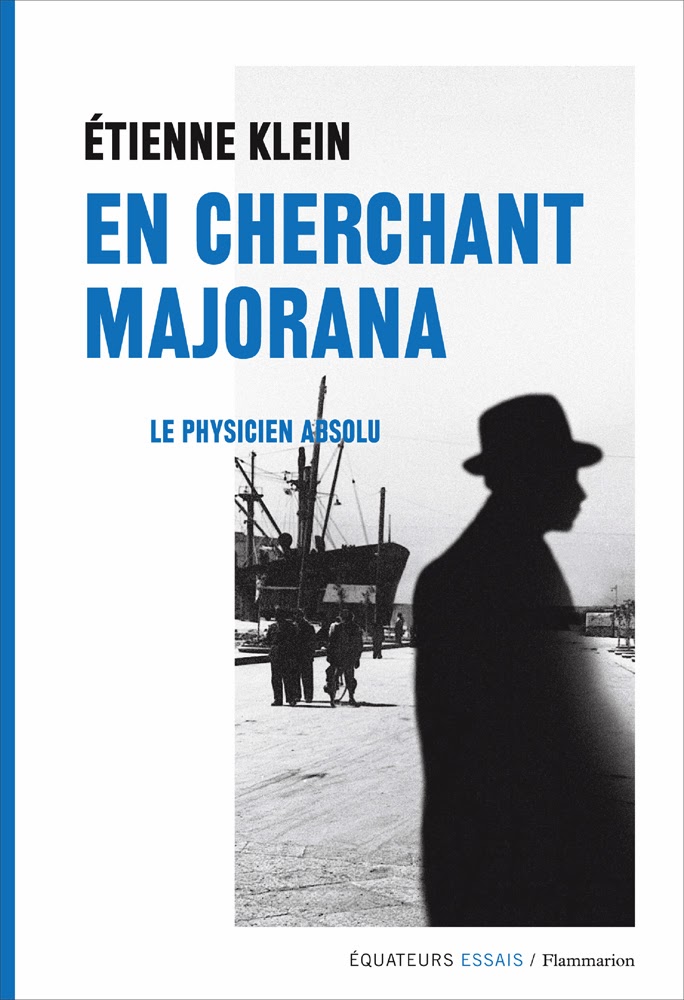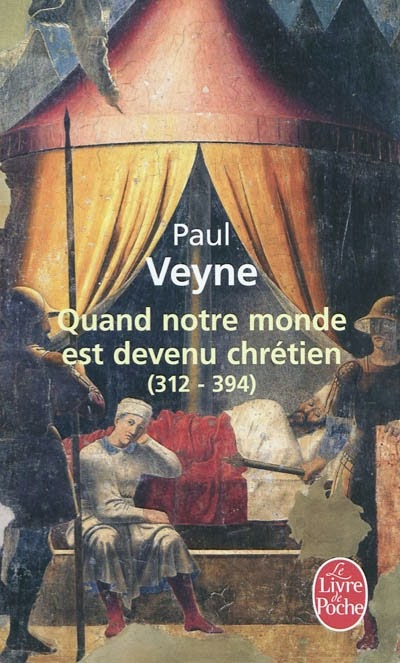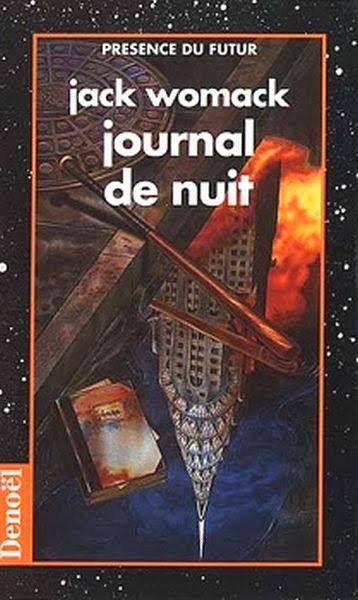 Lo-Ann Hart, une new-yorkaise de 12 ans reçoit un journal où écrire ses pensées pour son anniversaire, journal qu’elle baptise « Anne ». Elle y parle de son école (privée, pour filles), des soucis permanents d’argent de ses parents, de sa petite soeur Cheryl, dite Boob, et un peu de ce qu’elle perçoit de la situation politique. Et là, justement… l’année des douze ans de Lo-Ann sera celle de tous les changements. Les parents de Lo perdent leur emploi, le Président des Etats-Unis est assassiné…
Lo-Ann Hart, une new-yorkaise de 12 ans reçoit un journal où écrire ses pensées pour son anniversaire, journal qu’elle baptise « Anne ». Elle y parle de son école (privée, pour filles), des soucis permanents d’argent de ses parents, de sa petite soeur Cheryl, dite Boob, et un peu de ce qu’elle perçoit de la situation politique. Et là, justement… l’année des douze ans de Lo-Ann sera celle de tous les changements. Les parents de Lo perdent leur emploi, le Président des Etats-Unis est assassiné…
Ce roman très fort, écrit au début des années 90, raconte l’explosion des Etats-Unis à travers le regard d’une enfant très intelligente forcée de grandir trop vite. L’exercice de style est réussi par la peinture impressionniste qu’il offre d’un monde en déliquescence : émeutes permanentes, fumée montant de Long Island et de Brooklyn, déchéance sociale d’un coupe de ceux qu’on appelait pas encore les bobos, perdant leur bel appartement de la 85ème rue pour être repoussés chez les Noirs, vers Harlem, violence des relations entre les sexes, repli d’une part de la société sur des valeurs hyper-conservatrices, camps de redressement chrétiens pour jeunes délinquants, changement du climat, et j’en passe. Les mois passés avec son journal seront pour Lo-Ann ceux de toutes les transformations et de toutes les terreurs. Le monde décrit est assez proche de celui de la BD Martha Washington goes to war : Amérique en éclatement, armée dans les rues, Présidents des Etats-Unis déconnectés de tout. Une partie des intuitions de l’auteur me semblent justes, notamment celle de l’hyper-sexualisation des relations garçons-filles. Le ton du livre, très fort, capture le lecteur dans son cauchemar au travers d’une collection de moments forts, notamment la déchéance scolaire de l’héroïne, ses relations avec ses copines – aussi frappées qu’elle par la bascule du monde, et son acculturation à la rue…
Le roman est une indéniable réussite, une science-fiction vue à travers l’intime, un des moyens les plus forts pour faire passer un monde et une situation. Une limite toutefois, pour chipoter : je trouve le livre prisonnier de son système. Le journal, unique point de vue, contient par force tous les éléments permettant de saisir l’évolution des sentiments et de la situation sociale de Lo et ses proches – je ne crois pas qu’aucun témoignage soit jamais aussi complet. Le roman aurait gagné à être un peu plus incohérent, a laissé plus de vides, de surprises, d’incongruités, où projeter l’imagination du lecteur.
Ce livre m’a été conseillé par la librairie Charybde. L’édition Présence du futur dont je dispose est épuisée, mais aux dernières nouvelles Charybde disposait encore de quelques exemplaires en excellent état à un prix modique.
[edit] le livre n’est plus disponible en Charybde, mais on le trouve en Scylla, à l’heure où j’écris.