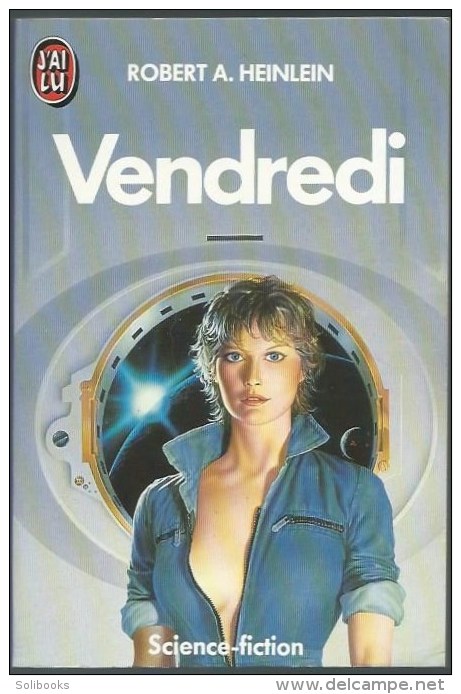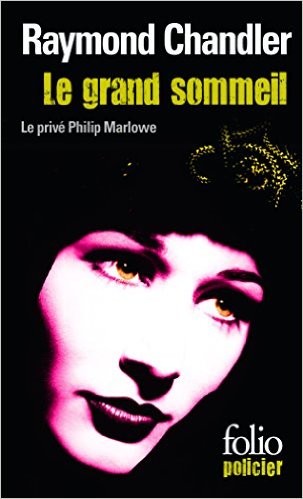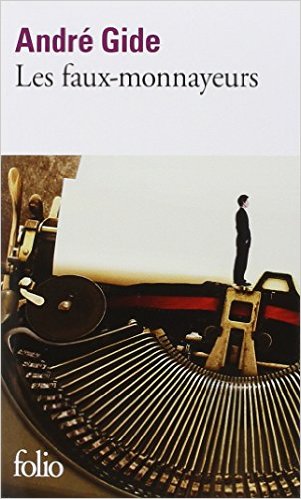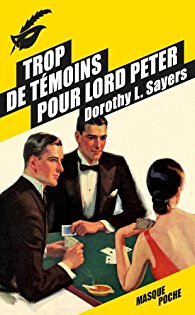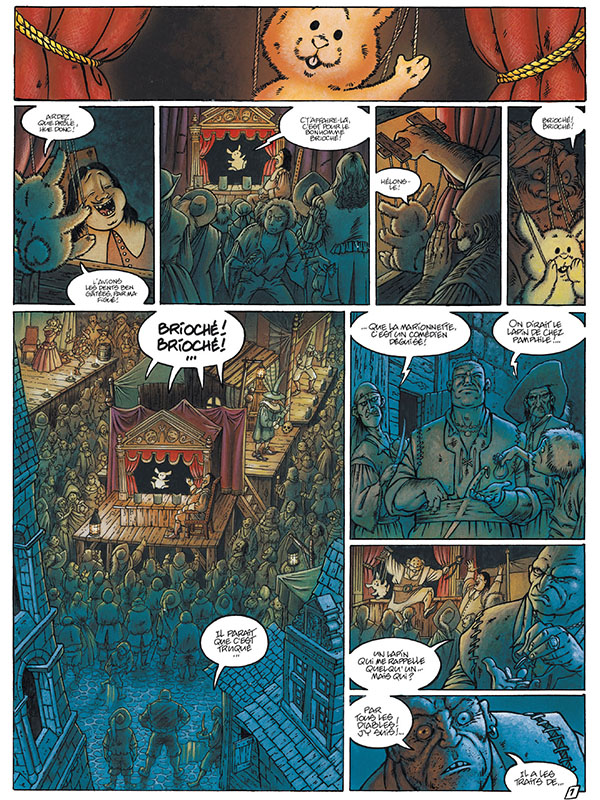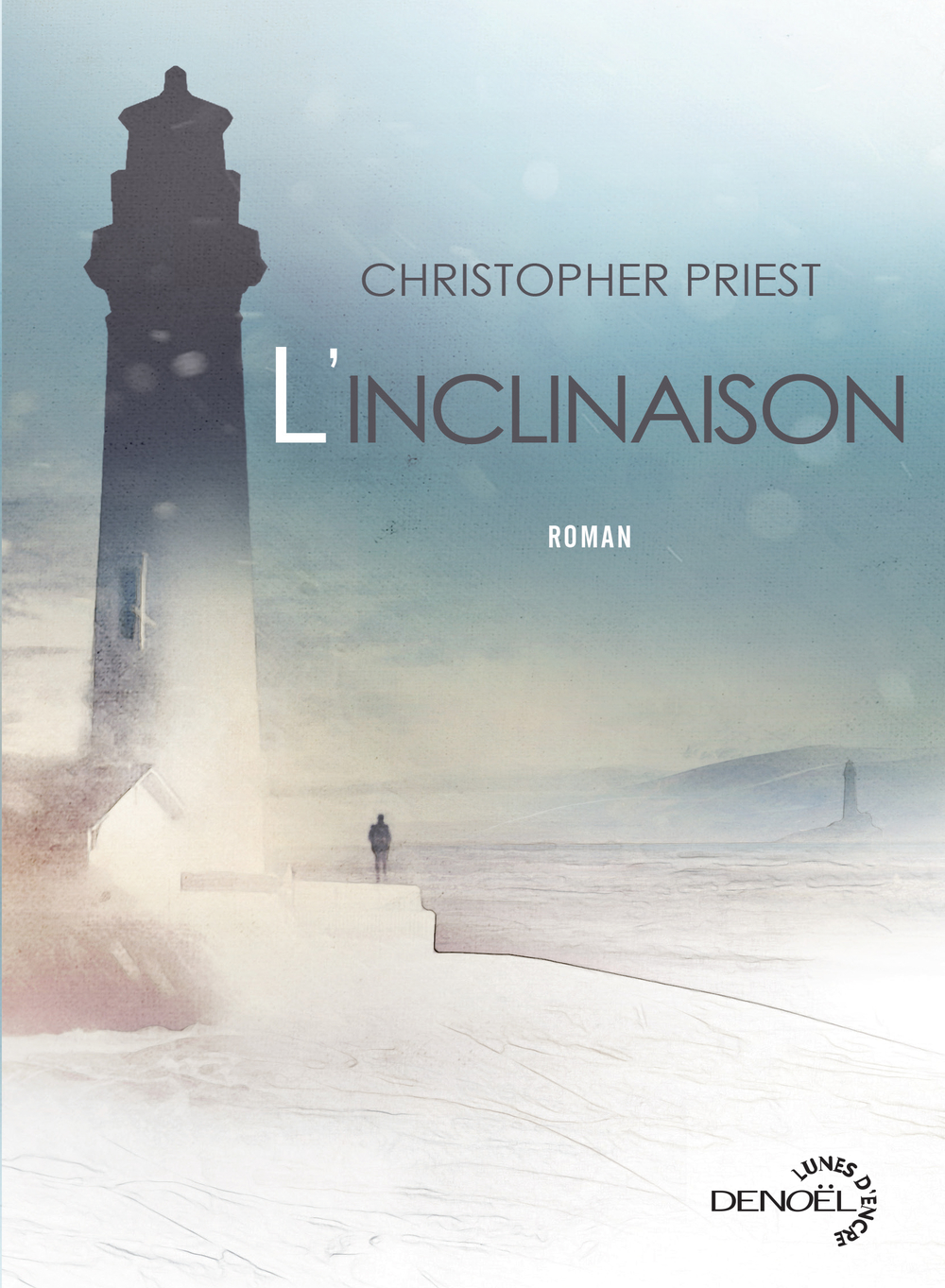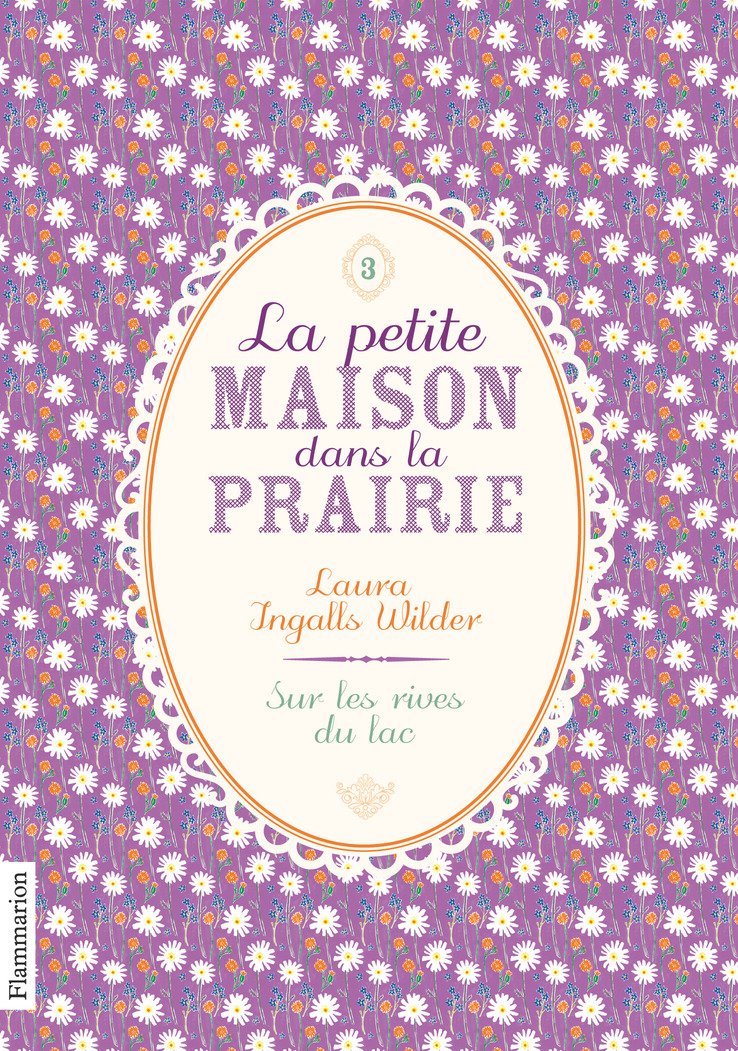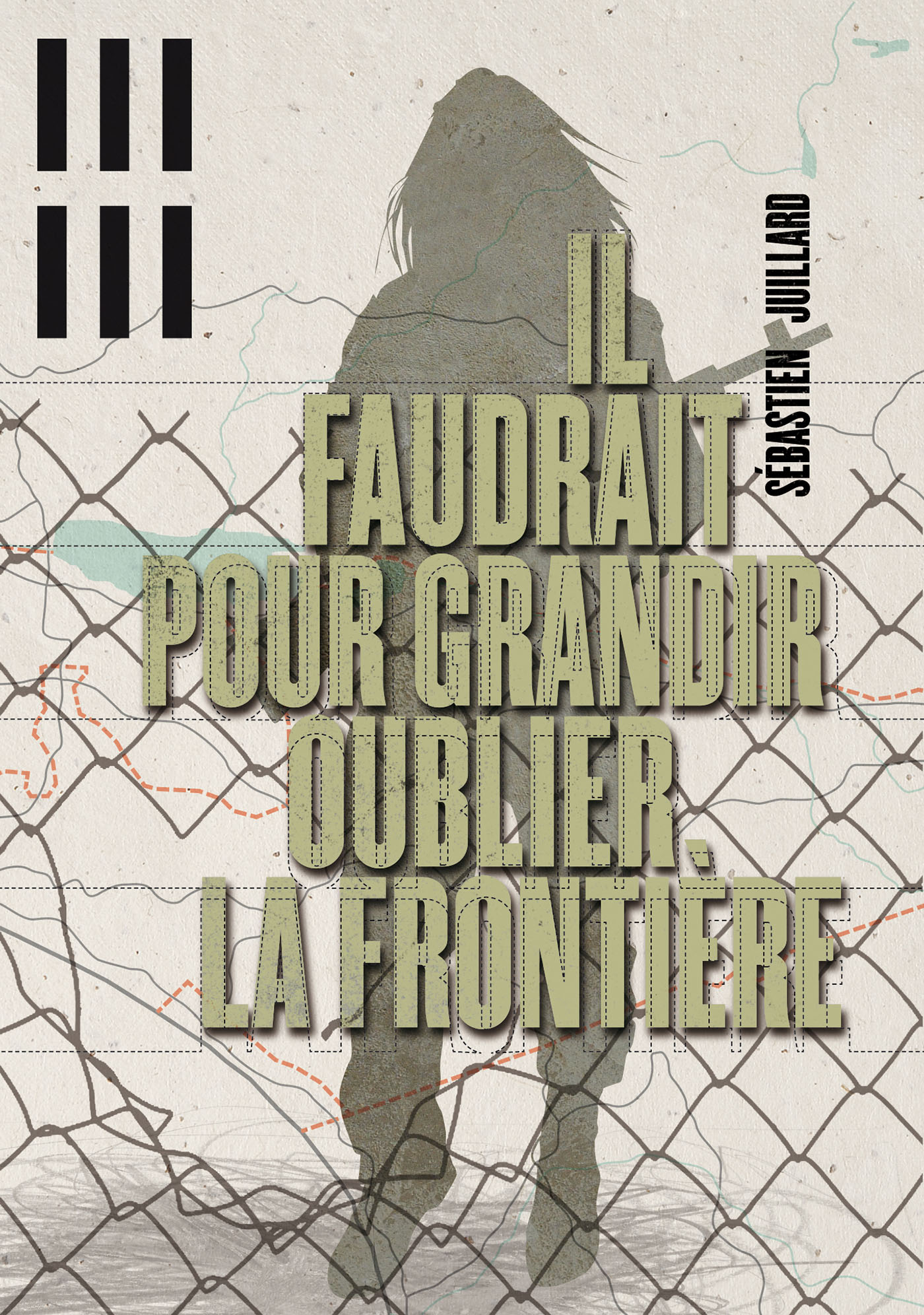Robert Heinlein fait partie de ces auteurs de l’âge d’or de la science-fiction que je n’ai pas lus pendant mon adolescence. Je n’ai donc pas de relation émotionnelle particulière avec lui. Je sais qu’il tient un rôle particulier dans l’histoire du genre, mais je n’ai pas réussi à accrocher à ceux de ses livres que j’ai lus : le premier était un juvenile intitulé sixième colonne, publié par Terre de brumes, que j’avais trouvé rigolo mais horriblement daté, le second, étoiles garde à vous, m’intéressait parce qu’il a inspiré un film que j’adore, Starship troopers. La lecture du roman m’avait réellement troublé, car là où le film est férocement ironique, le roman ne l’est pas, dans sa présentation d’une démocratie militaire.
Venons en à Vendredi. Vendredi est le nom de l’héroïne, qui nous parle à la première personne durant tout le livre, ce dernier constituant des sortes de mémoires. Vendredi vit dans un futur assez proche, avec colonisation spatiale, Etats-Unis balkanisés, affrontement d’Etats et de Transnationales… Elle est un courrier, sorte de super agent d’élite, forte, rapide, habile, intelligente et belle. Elle travaille pour une ONG mystérieuse, dont elle ne sait pas grand chose (ce qui est pratique quand elle se fait capturer), qui la paye bien et l’emploie au maximum de ses capacités. Ah oui, Vendredi est aussi un Etre Artificiel, un humain né en éprouvettes, amélioré génétiquement avec un gros paquet de bonus.
Ce qui fait les qualités de ce roman: l’héroïne est énergique, sympathique, joyeuse, et elle est propulsée à travers des intrigues géopolitiques tellement tordues que personne n’y comprend rien (elle non plus), se faisant des amis, des amants, tentant de survivre à toutes sortes d’avanies. J’ai eu l’impression qu’elle passait son temps à courir de ci, de là, fuyant les ennuis, les précédant parfois, l’ensemble est assez drôle.
Le livre est bourré d’idées de SF: Etats-Unis balkanisés, mariages polyamoureux, vols balistiques, terroristes de tous poils (vraiment bizarres), racisme envers les Etres Artificiels, technologies de rupture carrément youpi (shipstones pour stocker l’énergie, véhicules anti-grav, et tout un tas de gens qui se déplacent quand même à cheval, réseaux informatiques… ), considérations sur la société, la fin des civilisations, la liberté sexuelle. Heinlein a des idées dans tous les sens et il arrive à en faire passer la plupart dans l’action, nous offrant un futur auquel je n’étais plus habitué, quelque part entre le cyberpunk et la SF de l’âge d’or, c’est très rafraîchissant. Le roman est du genre picaresque, on va ici ou là sans vraiment de trame, ça fait partie du charme et des limites du texte. Les limites, venons-y : d’interminables dialogues, une apologie hyper datée de la liberté sexuelle, pleine de sentimentalisme et de nunucheries dignes d’un mauvais soap. Une fascination pour les questions de comptes en banques et de cartes de crédit, qui m’a bien saoulé et m’a fait lire en diagonale des dizaines de pages, un manque global de structure qui empêche d’accorder des enjeux à l’histoire.
Bref, c’est un très drôle de livre, plein de visions justes (sachant qu’il date de 1982 ! – propagandes, société de surveillance, multinationales militarisées), d’apologies de la liberté, valeur cardinale de l’héroïne, de respect de la personne humaine, de coucheries (racontées sagement) et d’aventures tadam ! Je me suis parfois ennuyé, j’ai été souvent intrigué et impressionné.
Cette notule très intéressante parue dans Bifrost situe le roman dans l’oeuvre d’Heinlein. J’en recommande chaudement la lecture !
Une très bonne chronique également, de Jo Walton.