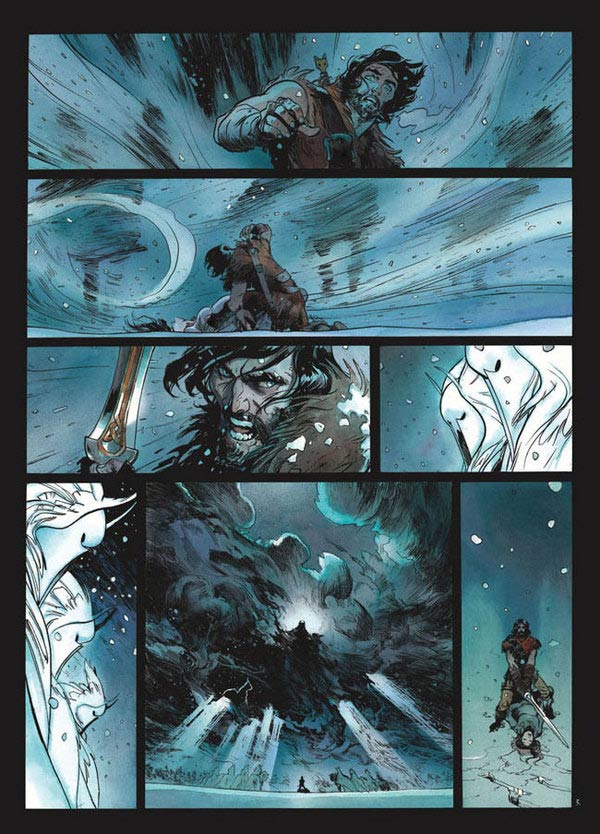J’aime beaucoup ce que fait la HP Lovecraft Historical Society. Chants de Noël, feuilletons radiophoniques, films… Il y a dans leurs productions un petit grain de folie délirante et sympathique.
Après le très remarquable Appel de Cthulhu, voici l’adaptation de la fameuse nouvelle The Whisperer in Darkness, façon long métrage (Cthulhu était un moyen-métrage).
La nouvelle d’origine, excellente, raconte le voyage dans le Vermont d’Albert Wilmarth un professeur de folklore de la très fameuse Miskatonic University. Là, le professeur Wilmarth va s’entretenir avec Henry Akeley, un fermier isolé, qui a vu dans les montagnes d’étranges choses…
La HPLHS a choisi, tout comme dans leur premier film, d’adapter Lovecraft comme s’il avait été tourné à l’époque. Effets spéciaux simples, noir et blanc, acteurs au jeu assez expressionniste. Ici la référence me semble être les premiers films d’horreur, façon Dracula ou Frankenstein. L’ensemble dégage un parfum d’amateurisme sympathique.
Soyons clair, le film n’est pas excellent, mais pas à cause cet cet amateurisme, qu’on peut pardonner. Certes, le jeu des acteurs n’est pas toujours très bon (même si les premiers rôles s’en sortent bien), la réalisation et le montage pourraient être meilleurs, mais tout ça n’est pas très grave, on leur pardonne, parce qu’on sent que ce film a été fait avec amour et bouts de ficelle. Ce qui nous a plus gêné est que l’esprit de Lovecraft n’a pas été complètement respecté dans le scénario, qui étend un peu le propos de la nouvelle.

On peut le découper en trois grosses parties.
– Un premier moment à l’université Miskatonic, où on voit Wilmarth entouré de ses confrères professeurs. Ce passage provoquera des pincements de nostalgie aux vieux joueurs de l’Adc, et, ma fois, est assez réussi. Personnages bien posés, jolies idées (je ne sais plus si les lunettes stéréoscopiques sont dans la nouvelle…), bonne introduction de l’intrigue et de ses enjeux.
– ensuite, le voyage dans le Vermont et la discussion avec Akeley. Là, on est vraiment proche de la nouvelle. Même si la narration filmique aurait gagné a suggérer un peu plus et montrer un peu moins, le rire bizarre d’Akeley vaut le détour… Rien à dire toutefois. J’aime les jeux d’ombres sur les créatures, notamment.
– la troisième partie, par contre, part dans le grand n’importe quoi pulp-style. Rituel, avion, bagarres… On entre dans un esprit mauvais scénario de jeu de rôle, certes rigolo, mais loin de HPL. Notamment parce qu’en rebouclant sur des clichés éculés (grand-prètre et rituel expliqué dans un vieux livre…) on perd l’ouverture à l’imagination laissée par la partie précédente du récit et par la nouvelle en général.

Ne boudez toutefois pas votre plaisir et soutenez les initiatives de la HPLHS. Si j’ai des réserves sur le film, ce dernier contient quand même de jolies réussites que je vous encourage à découvrir. Le projet est chouette et j’espère qu’ils continueront à produire des bizarreries de ce genre. Moi, j’achète !
[edit] pour se procurer les produits de la HPLHS, allez sur leur site ! Même leurs factures sont Cthulhu designed.
![[Publicité] Petites morts](https://laurent.kloetzer.fr/wp-content/uploads/2012/01/Petites-Morts-C1.gif)