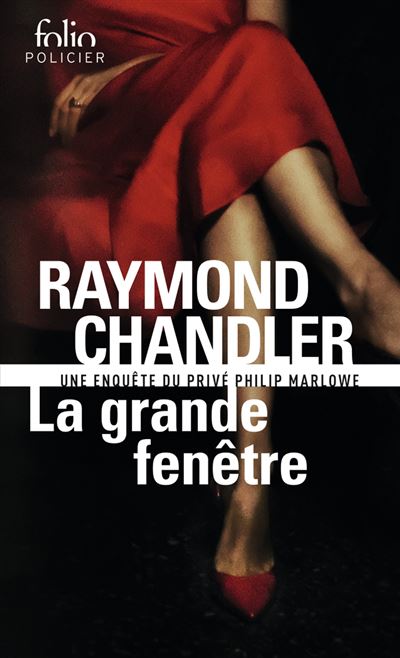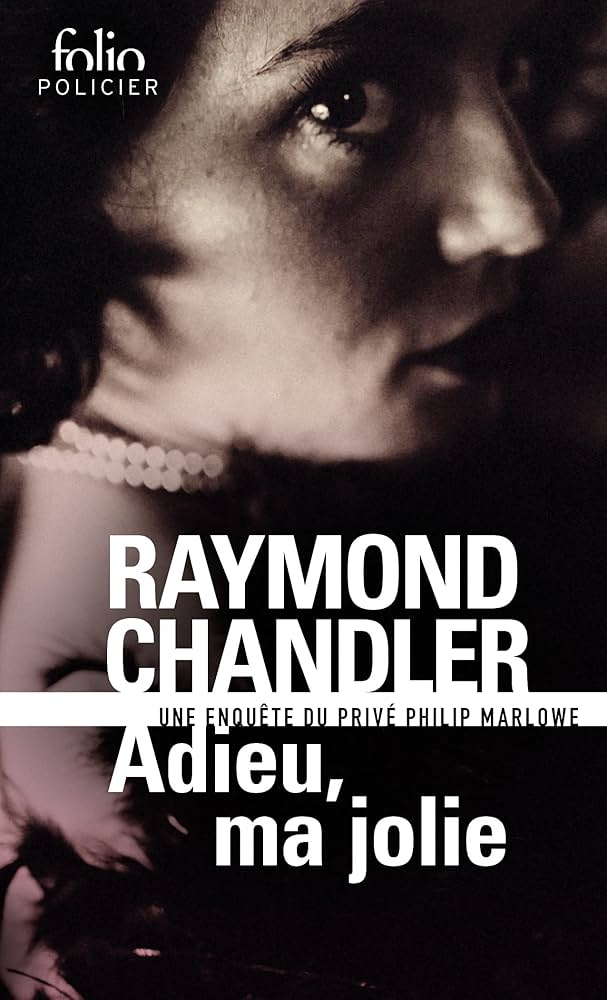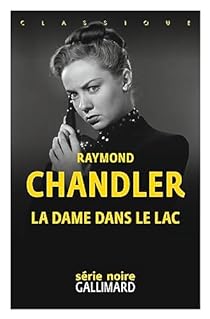Je pense régulièrement que Molière est sur-côté, notamment à côté de Shakespeare.
Puis, des fois, on voit un truc comme ce malade imaginaire, et en fait, non. Molière, quand même.
Donc Argan est malade, au début il est assis sur une drôle de chaise d’hôpital XVIIème qui est aussi son chiotte, il compte son fric, il en a, celui qu’il va donner à ses pharmaciens fournisseurs, et c’est marrant.
Après il va ignorer le soupirant de sa fille (Cléante), tenter de refiler la gamine à Thomas Diafoirus qui est un débile profond mais tout à fait bien membré et capable d’engendrer des fils (c’est le texte qui le dit), se faire manipuler par sa seconde épouse qui lui donne du « mon fils », équivalent 17ème de « mon gros bébé », se faire faire la leçon par son frère, hurler en méta contre Molière et ses comédiens et lui souhaiter la mort et à la fin, se faire ordonner médecin dans un grand nonsense de danses et de litanies en latin de cuisine, énorme WTF en ballet d’arlequins pour former l’image finale.
Ce qui est beau, dans cette mise en scène de Claude Stratz (vieille de 20 ans, et fun fact, le Claude fut suisse et bossa comme assistant en psycho à Piaget avant de se lancer dans le théâtre, fin de parenthèse), ce qui est beau, donc, c’est qu’on entre dans l’esprit de cet homme. Ca devrait être un con, on devrait le détester, ce sale bourgeois trop bouché, mais en fait on entre dans sa folie et ce, qui est le plus terrible, on la comprend. Parce que la mort rode, tout le temps, dans cette grande maison vide que la scène dessine. Il y a des courants d’air, des rideaux qui se soulèvent, les chiens aboient dans le lointain. Et oui, les jeunes Cléante et Angélique sont bien mignons, et Toinette se démène, et ceux-là vont vivre et s’amuser encore, mais dès qu’il se taise le silence et le froid envahissent tout et moi, dans le silence entre les mots, entre les cris et entre deux passages sur le trône, je comprends l’inquiétude d’Argan.
Il a peur. Il a peur de la mort.
Et c’est pour ça qu’on rit et que la pièce est bien et que Molière, quand même, oui.
Ha oui, en voyant la première scène je me suis rendu compte qu’en fait… on l’avait déjà vue. Il y a plus de vingt ans, lors des premières fois de cette belle mise en scène, avec d’autres acteurs (ou bien les mêmes pour certaisn rôles), avant que ce blog n’existe.