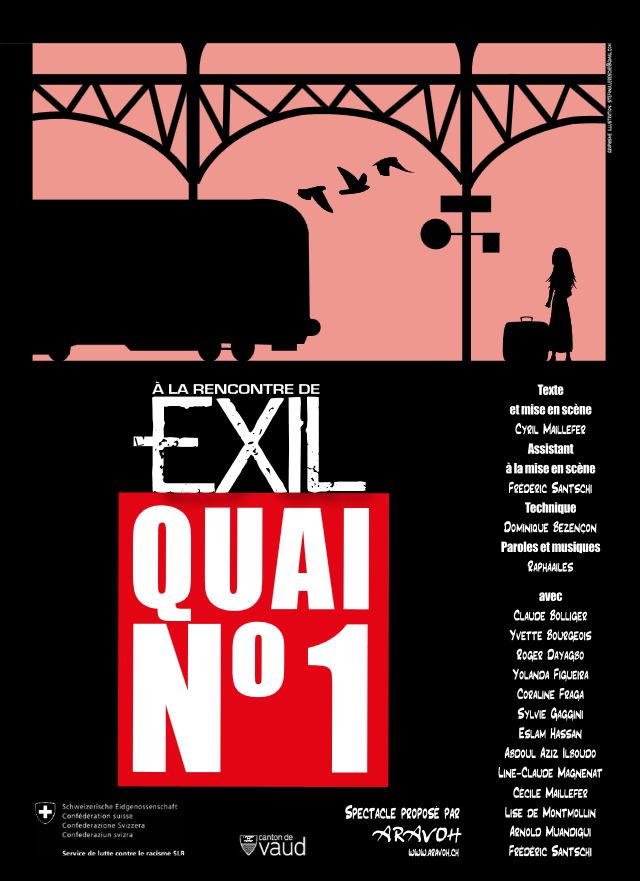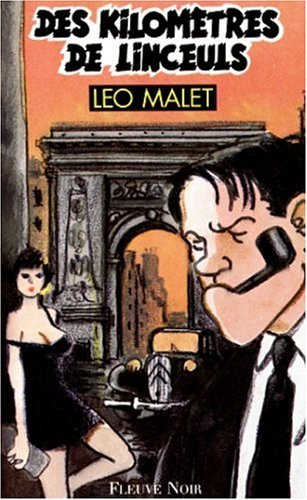L’éditeur Dystopia workshop lance une opération de financement pour un beau projet, avec lequel j’ai une relation personnelle forte.
Voici déjà le lien du projet. Allez-y voir, ça en vaut la peine.
http://www.dystopia.fr/financement/adar-retour-a-yirminadingrad
Puis, si quelques souvenirs vous intéressent, voici mon implication dans cette affaire.
C’était en 2009 ou en 2010, à la librairie Scylla, que j’ai rencontré en même temps Yirminadingrad et Jacques Mucchielli. Le livre Yama Loka terminus était posé en évidence sur le comptoir, j’en avais lu la critique sur le Cafard Cosmique, je l’ai pris parce qu’un des auteurs était là, que ça donnait l’occasion de bavarder. Jacques et moi avons bien accroché.
Plus tard, j’ai lu le livre et je l’ai aimé (ma chronique ici). Je me suis retrouvé dans la ville déglinguée des bords de la mer noire, dans le projet chaotique pour la faire vivre par des chroniques, des récits, drôles, tristes, violents, sexuels, bizarres, incohérents, je m’y suis trouvé une maison.
Je me suis aussi retrouvé dans le drôle de processus de création collective, qui me rappelait un peu certains des procédés du jeu de rôle, avec la littérature et sans les clichés. Les auteurs de Yama Loka, et de Bara Yogoï tentaient de répondre à cette question : comment faire, à deux, à trois (avec Stéphane Perger) pour donner naissance à quelque chose d’intéressant ?
L’année d’après, aux Utopiales, Jacques m’a présenté Léo, ils m’ont proposé de venir à Yirminadingrad à mon tour. J’ai fait le voyage, la route des exilés avec eux, j’ai vu bourgeonner ce qui a longtemps été pour moi le projet 19 dans mes notes personnelles et qui est devenu Tadjélé. (ici, la belle chronique de la revue Frontières)
Dans l’écriture, on se pose beaucoup de questions, on explore, il faut être patient, tranquille, accepter que de nombreuses routes ne mènent nulle part. Yirminadingrad a été pour moi une grande découverte, la possibilité d’autre chose, de quelque chose de juste et de joyeux. La ville et les rêves de la ville ont tout de suite infusé mon travail, comme si cela avait toujours fait partie de mon univers intérieur. L’Anamnèse de Lady Star y contient plusieurs allusions, Petites Morts aussi.
Jacques est mort avant de voir Tadjélé, mais le projet 13 était déjà en route. Dans ce quatrième et dernier livre de la série, les deux créateurs d’origine n’ont écrit aucun texte mais ont invité des amis, des amateurs, à écrire à leur tour – sans attribution des textes – sur la ville de Yirminadingrad. Nous sommes treize à être venus en touristes dans la cité des Yirminites et des Adiniens : Stéphane Beauverger, David Calvo, Alain Damasio, Mélanie Fazi, Vincent Gessler, Sébastien Juillard, Laurent Kloetzer, luvan, Norbert Merjagnan, Jérôme Noirez, Anne-Sylvie Salzman et Maheva Stephan-Bugni.
J’ai eu le privilège de lire les textes en avant-première et croyez-moi si vous voulez, mais ce n’est pas une antho comme une autre, parce que dès le début elle a été conçue comme un livre complet, les textes étant tous appuyés sur treize images de Stéphane Perger. L’ensemble m’a ému et secoué.
Maintenant, ce livre a beau avoir été écrit, il n’existe pas encore. Le projet des éditions dystopia pour le faire naître est ambitieux, et il a besoin de vous. Tout est expliqué ici. Allez-y voir, pré-commandez le livre si vous le pouvez, vous ne le regretterez pas.
Yirminadingrad vivra !