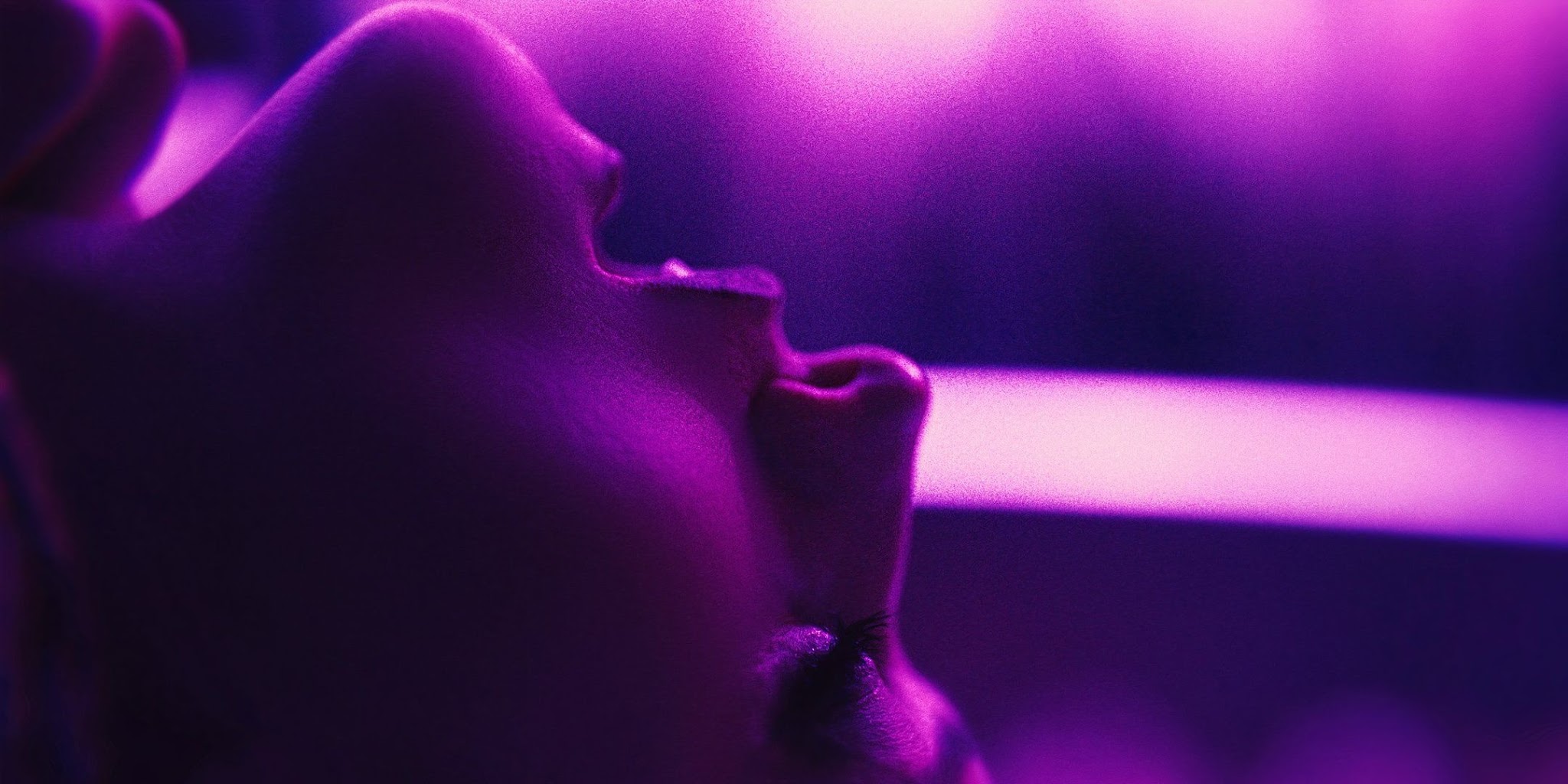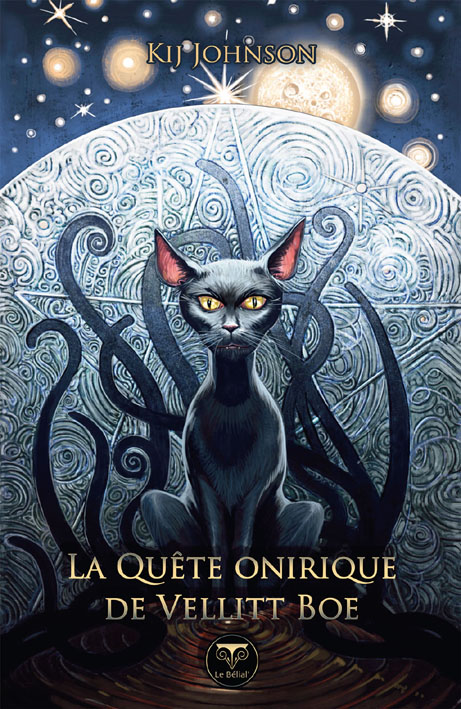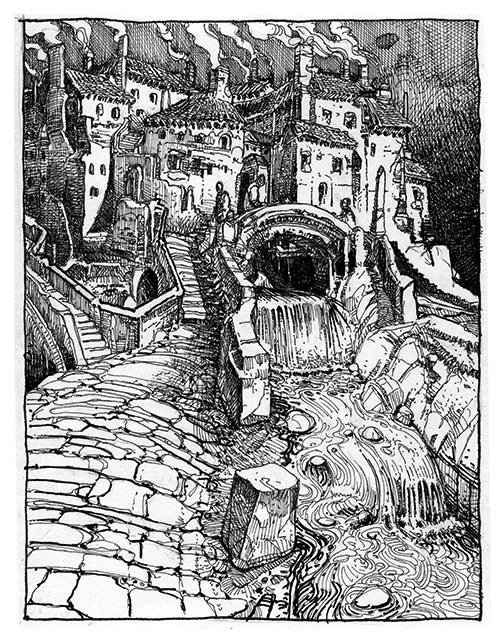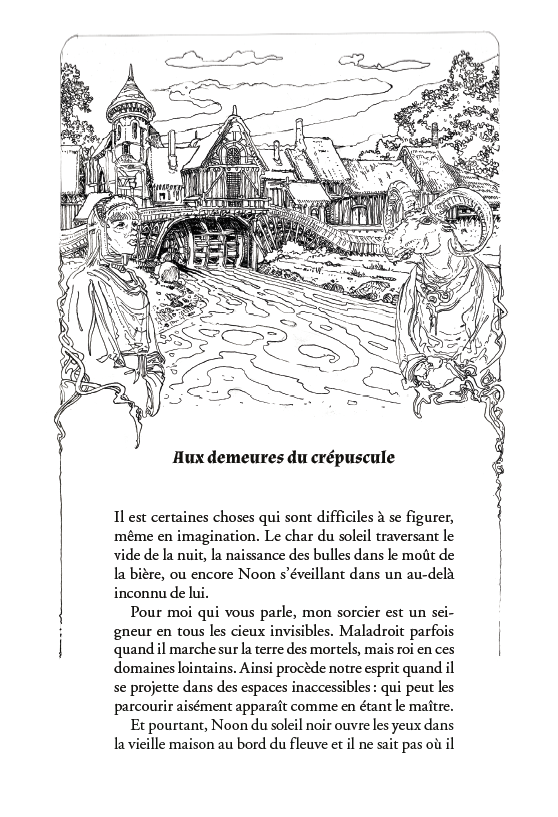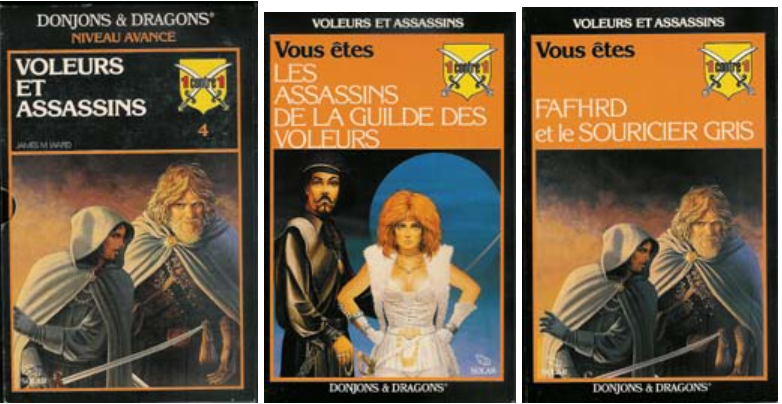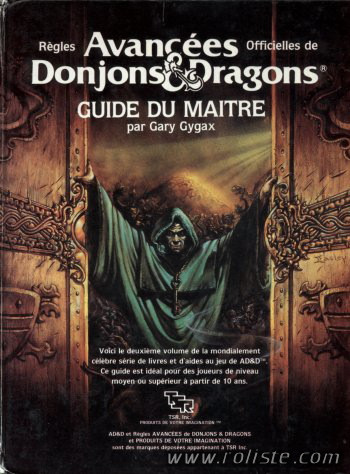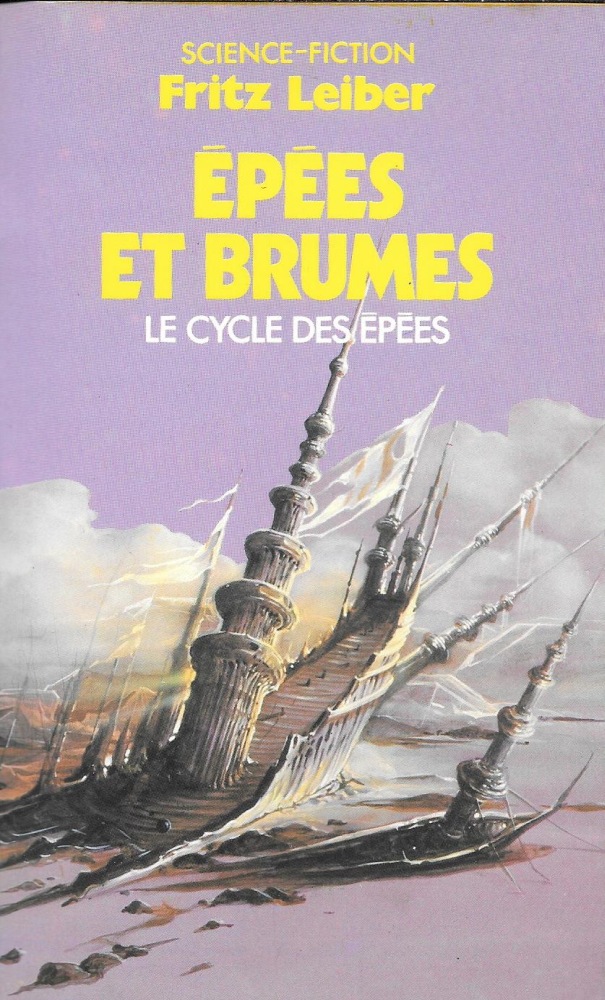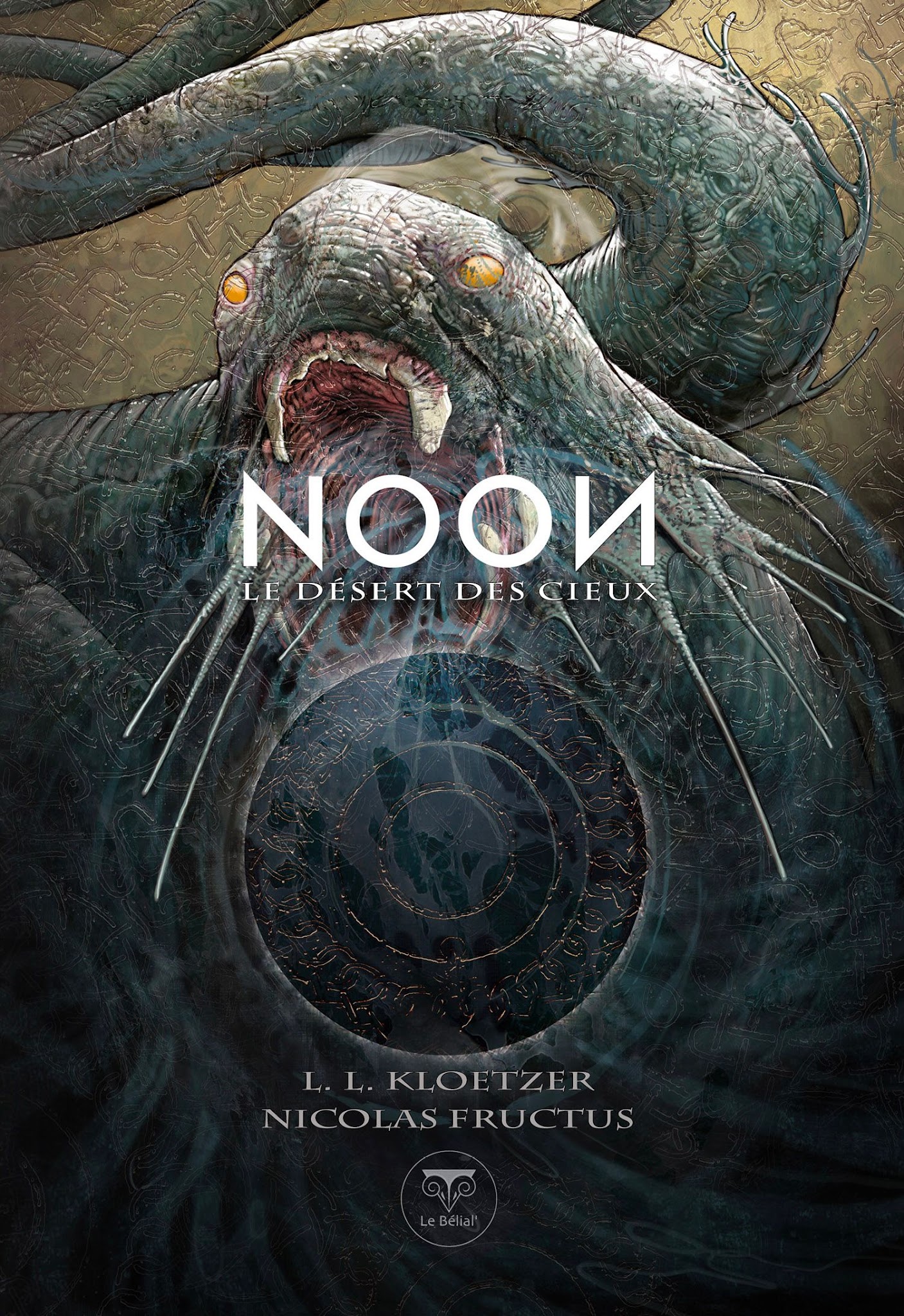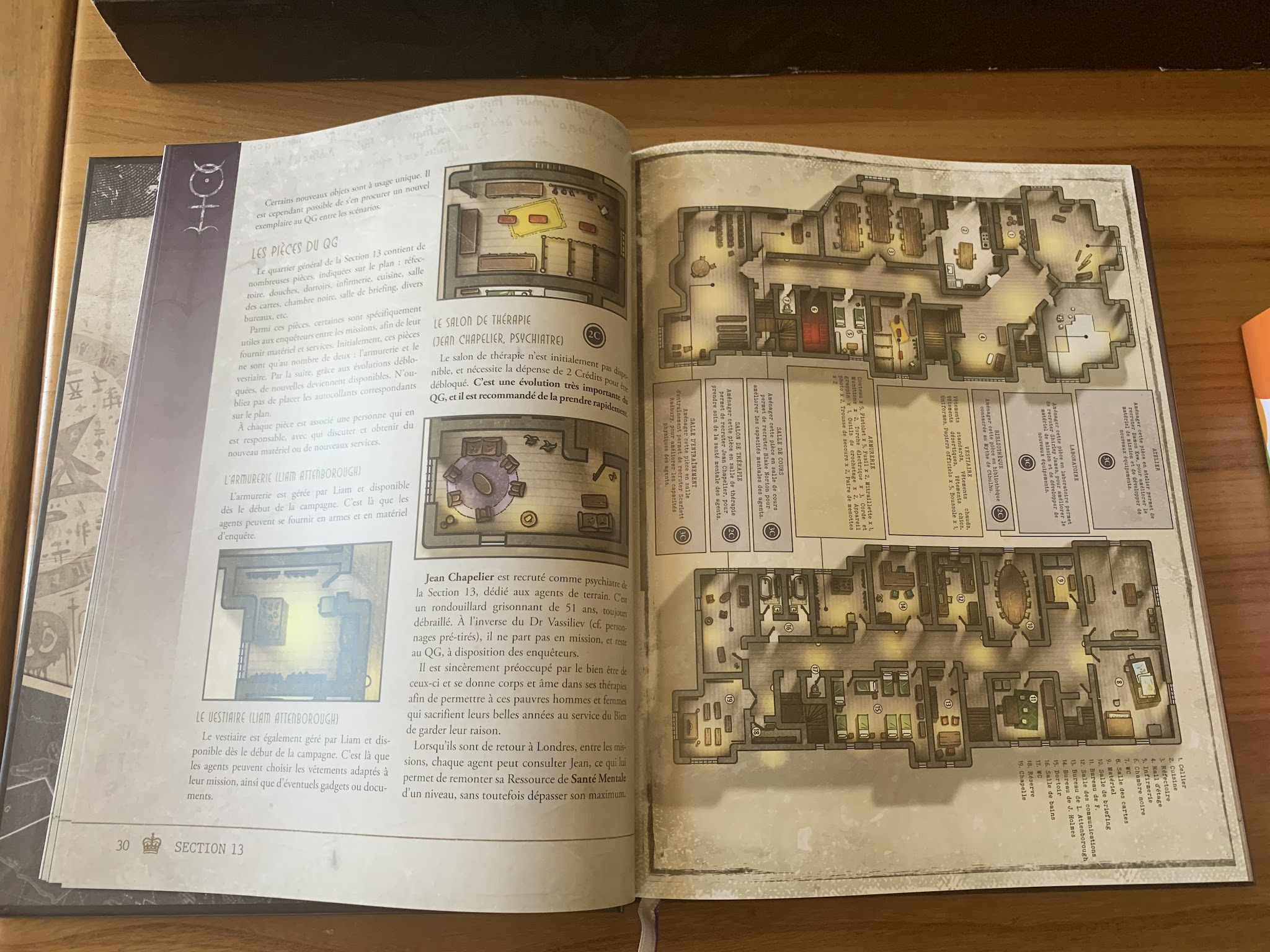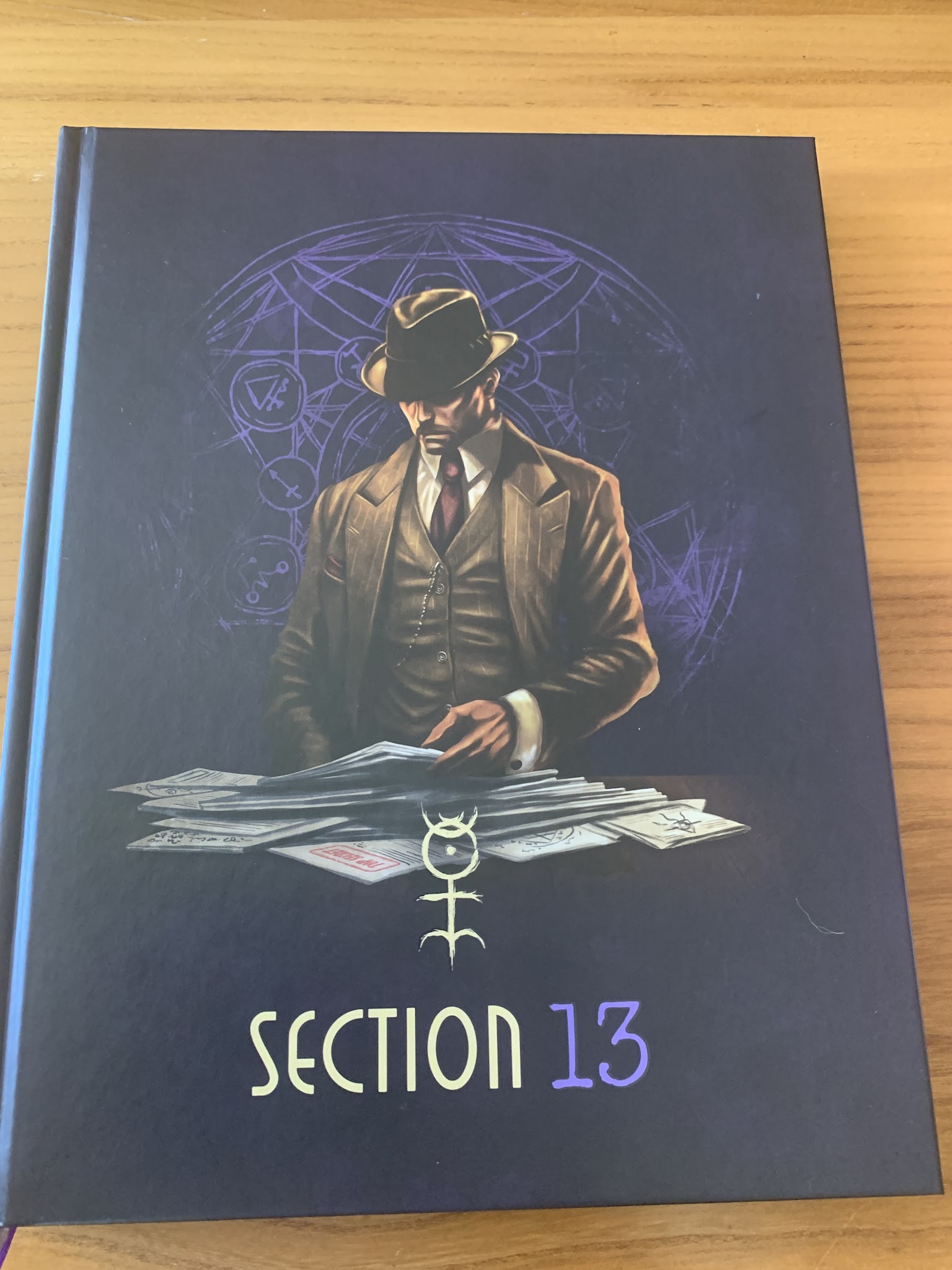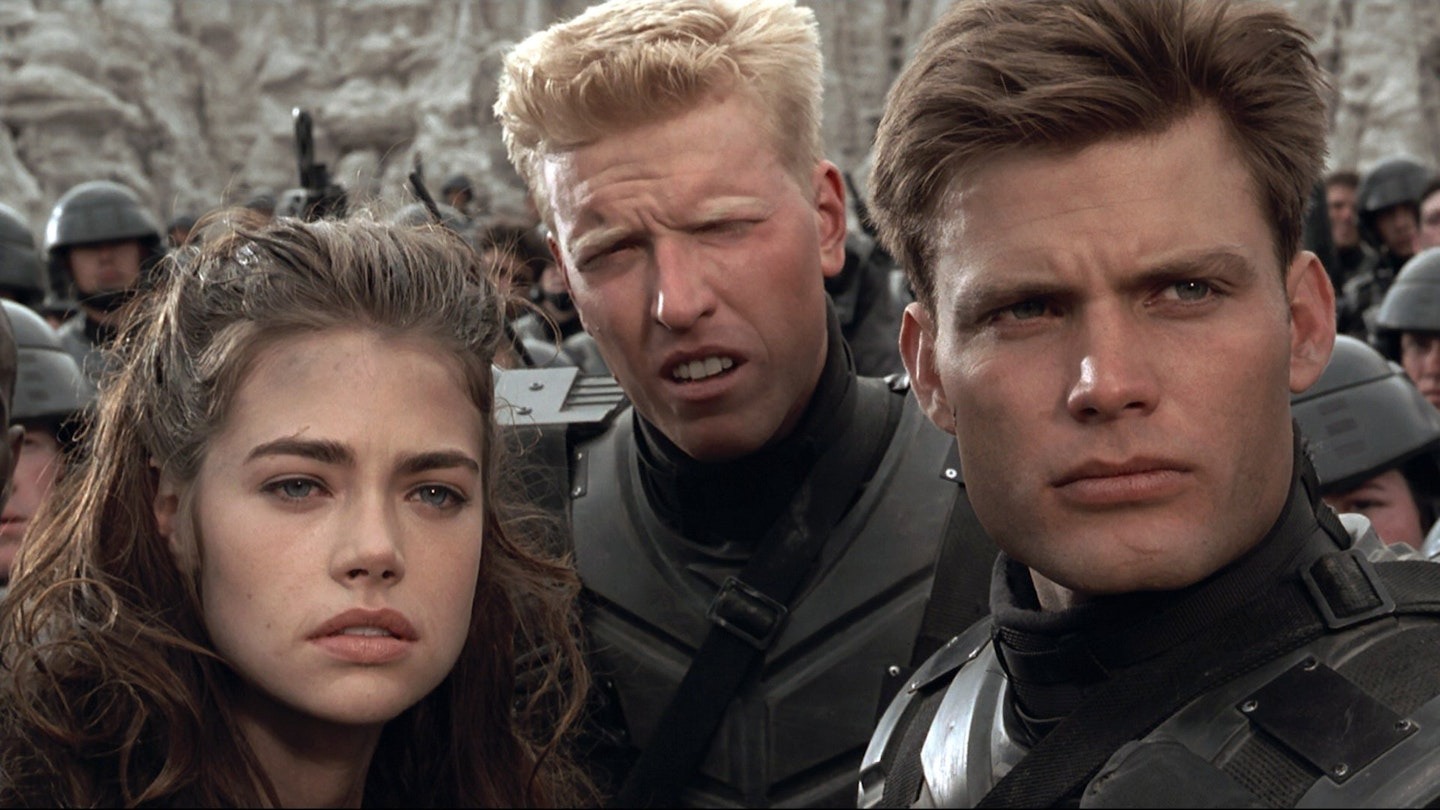Un texte plus long que d’habitude sur ce blog, à l’occasion de la parution du désert des cieux.
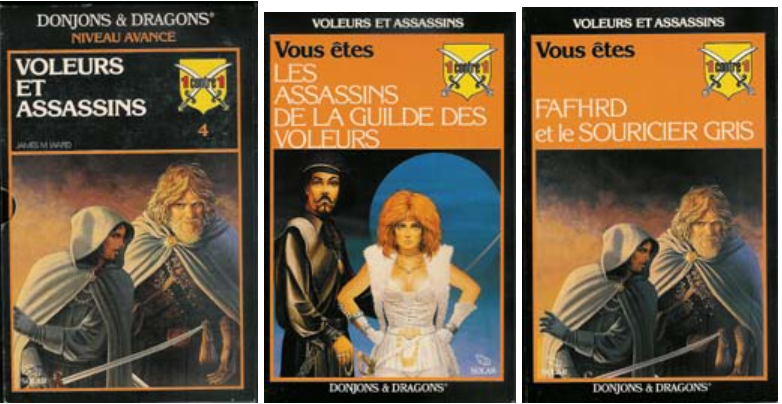
Visiter des lieux qui n’existent pas est une affaire de
rencontres. On n’entre pas par hasard dans des mondes imaginaires : il
faut une personne qui vous guide pour passer la porte. Qui m’a accompagné dans
le monde de Nehwon ? Les deux voleurs les plus cools du monde, Fafhrd et
le Souricier gris, évidemment.
Je dois avoir une quinzaine d’années, et je joue à AD&D
au collège. Et mon meilleur pote me prête une paire de livres dont vous êtes le
héros mettant en scène deux personnages comme je n’en avais jamais vus :
Fafhrd (barbare, balaise, roux, scalde, grosse épée) et le Souricier Gris
(mince, fine moustache à la Errol Flynn, voleur, rapière, bribes de magie). Une
feuille de perso, des dessins en noir et blanc, et des embrouilles avec la
guide des voleurs ou bien celle des assassins, je ne sais plus. Ces deux gars
me plaisent tout de suite.
J’apprends à les connaître mieux, car à la fin du guide du
maître AD&D, ce compendium bordélique, je découvre les recommandations de
lecture de Gary G. Jack Vance, Robert Howard, Tolkien bien sûr (que j’avais
déjà lu) et surtout : Fritz Leiber, le cycle des épées. Un cycle
disparate de nouvelles mettant en scène les même deux types sympathiques
rencontrés plus haut. Des poches Presse Pocket avec ces couvertures
surréalistes zarbi de Siudmak, une demi-douzaine de tomes ne formant pas une
saga ample et sérieuse, oh non. Quatre à six histoires par volume. Des
aventures où nos héros rencontrent sorciers, voleurs, zinzins de toutes sortes
et femmes fatales, dont ils se sortent généralement les poches vides, l’humeur
mélancolique avec sur les lèvres le souvenir d’un baiser. J’étais ado, j’ai
adoré leurs sarcasmes et leur mélancolie. Le monde leur échappe, ils ne
contrôlent pas grand-chose, ils se moquent d’eux-mêmes. Et surtout, ils sont
amis, les meilleurs amis du monde. Ça ne me surprendra pas, plus tard, quand j’apprendrai
que Fafhrd, c’était Leiber, et le Souricier, Otto Fisher, et que ces deux-là
s’entendaient très bien.
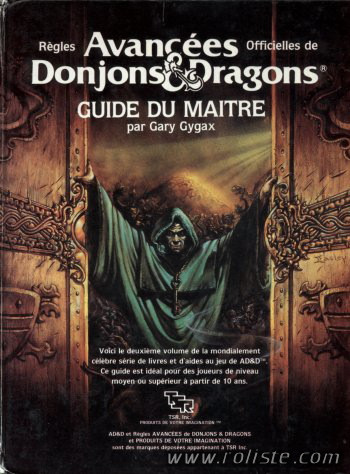
Leur ville s’appelle Lankhmar. Un peu Chicago, un peu
Constantinople, peut-être la première projection dans la fantasy de l’univers
urbain du 20ème siècle. Lankhmar, grouillante et merveilleuse, avec
son gouvernement de travers, ses marchands plein de pognon, ses mendiants et sa
guilde des voleurs. Lankhmar, au cœur du monde de Nehwon (lisez-ce nom à
l’envers, « le monde de nul temps »), un monde imaginaire aux cartes
floues, à l’histoire rêvée.
J’ai aimé les deux amis, j’ai lu toutes leurs histoires
plusieurs fois, celle avec les rats, celle avec le roi sous la mer qui n’est
pas là, celle avec les dieux en haut de la montagne, celle avec les deux frères
fous ennemis dans les souterrains de Quarmall, celle où Fafhrd devient disciple
d’Issek, celle avec les oiseaux qui crèvent les yeux, celle avec le bazar du
bizarre, celle avec le personnage qui rêve depuis sa tombe, celle où la Mort,
assise sur son trône, tue au rythme du battement de son coeur… Et tout ça a
fait partie de moi.
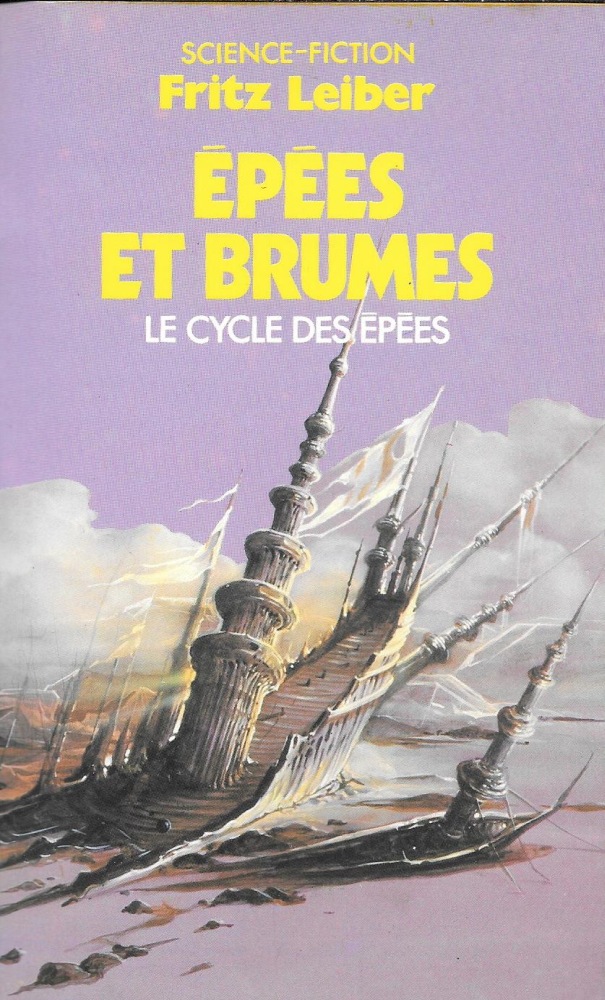
Des années passent. Lors d’une promenade vers la source,
Laure et moi nous inventons des personnages (c’est une activité qui nous prend
parfois, quand nous trouvons qu’il n’y a plus assez d’histoires dans notre
vie). Nous parlons de Lankhmar. Ces personnages pourraient y vivre : l’un
serait un jeune homme excentrique et timide, un sorcier aux pouvoirs bizarres.
Et l’autre, un vieux mercenaire à la jambe fatiguée, son compagnon et
assistant. Ils habiteraient au dernier étage d’une maison de passe à l’enseigne
du soleil noir, il y aurait des tentacules au plafond, et les gens viendraient
les voir pour exposer leurs problèmes, ils vivraient des sortes d’enquêtes, tu
vois ? Avec de la magie. Deux types célibataires partageant un
appartement : bien sûr nous pensons au détective de Baker Street et à son
compagnon. Nous en sommes tous les deux fans. Nous rêvons ces deux-là, Laure
s’amuse à inventer les pratiques professionnelles de ce métier qui n’existe
pas : sorcier de ville, grande magie pour tous les jours. Nous
découvrons comment la magie contraint les vêtements, les contrats ou les
questions immobilières. Nous passons du temps avec eux, puis ils s’éloignent… Laure
en reparle de temps en temps : est-ce les aventures du magicien et du
mercenaire ne pourraient pas faire de bonnes histoires à écrire ? On
pourrait faire une série de livres, on pourrait faire du YA (on n’a jamais
essayé ce genre de récit, non ?). On pourrait écrire quelque chose pour
nos filles. Oui, peut-être, si tu veux ; en vérité je n’y crois pas tellement,
je n’y crois pas assez.
Les histoires se cristallisent quand elles veulent et quand
on peut. Dix après avoir inventé le sorcier et son compagnon, nous écrivons une
nouvelle les mettant en scène. J’avais pris peu de notes, alors on se rappelait
surtout l’impression qu’ils nous avaient fait, leurs caractères, pas
grand-chose de plus ; nous réinventons la plupart des détails, comme par
exemple, leurs noms. La nouvelle s’appelle « à l’enseigne du soleil
noir », et elle commence comme ça :
Je m’appelle Yors, j’ai beau être boiteux, je me
considère plutôt comme un dur à cuire. J’ai été marin sur une galère de la Mer
Intérieure, docker sur le port, sergent dans l’armée du Suzerain…
J’ai connu les batailles, les blessures et les naufrages, j’ai toujours su me
débrouiller et m’en sortir, plus ou moins entier. Mais maintenant je ne suis
plus tout jeune, je cherche un peu de stabilité et de tranquillité, alors je
suis entré au service de ce drôle de type, à l’enseigne du soleil noir.
Elle fait 80 000 signes. Il y a dedans Noon, Yors, une belle
voleuse, un médaillon perdu et un drôle de ratier. Et déjà, l’attention aux
détails, l’aversion de Noon pour les dettes, son goût pour la liberté, son
attention aux choses minuscules qui révèlent le tout. On voudrait que ce texte
soit lisible par les adultes et les enfants. Marguerite, alors âgée de onze ans,
le lit et nous dit que oui, c’est cool, les personnages sont bien, mais on
aimerait savoir plein de trucs en plus à leur sujet. Où Yors et Noon se
sont-ils rencontrés ? Pourquoi se sont-ils installés ensemble ? D’où, et
comment, et quoi, et pourquoi ?
Deux ans plus tard, parce que la pandémie douche un peu nos
envies de SF, nous reprenons la même histoire, depuis le tout début ; tout
réécrire, sans relire, de mémoire encore. Le souvenir d’un souvenir. Yors
cherche du boulot, à la porte de l’Est. Arrive un jeune homme un peu
excentrique et très riche qui dit s’appeler Noon, mais on sait tout de suite
que ce n’est pas son vrai nom. Finalement Noon n’est pas aussi fortuné qu’on
pense et il va falloir trouver du travail, et ce sera de la sorcellerie.
Nous sommes dans la ville aux mille fumées, notre ville,
plus Constantinople que Chicago (parce que j’aime l’histoire antique) ; des
gens vivent ici, et y travaillent (parce que le travail des gens est important
pour Laure). Les eunuques tiennent le palais, les pauvres tirent le diable par
la queue et Yors est un homme qui se sent vieillir. Mais heureusement, il a
croisé Noon, et vivre dans le même monde que Noon, c’est merveilleux, parce que
Noon prend les choses à sa manière, par la bande, par au-dessus, par l’au-delà,
et l’impossible devient possible. Pour celui qui sait voir, le monde est plus
vaste, plus effrayant peut-être, plus beau certainement. Les portes s’ouvrent
qui étaient fermées à jamais, les chaînes se rompent, ce qui était perdu est
retrouvé, les amants séparés sont réunis.
Olivier du Bélial, nous a fait rencontrer Nicolas, qui aime
les cités imaginaires, les magiciens et les hommes-serpents autant que nous.
Pour Nicolas, la fantasy est une affaire sérieuse, les personnages sont
présents et les bâtiments sont à la fois habités et vivants. Pour lui comme
pour nous ces histoires sont ouvertes et les illustrations, comme les textes,
sont une invitation, à ouvrir le monde, à créer des espaces de liberté.
Voilà, ça s’est passé comme ça. Noon et Yors et Meg ont
maintenant leur lot d’aventures (trois livres !) : avec le jeune
homme riche plongé dans les ennuis, les ramasseurs de morts, les princes
mingols en goguette, les dieux contrariés. Le magicien parvient, d’une certaine
façon, à se rapprocher du Suzerain et ce grand pudique apprend deux ou trois
trucs au sujet de l’amour.
Nous, nous sommes heureux d’avoir vu ce monde apparaître,
dans nos rêves, dans nos souvenirs, dans les dessins de Nicolas, comme une
image qui se révèle derrière une vitre embuée. à vous de le découvrir, si vous le
souhaitez.
Sundered
from us by gulfs of time and stranger dimensions dreams the ancient world of
Nehwon with its towers and skulls and jewels, its swords and sorceries.