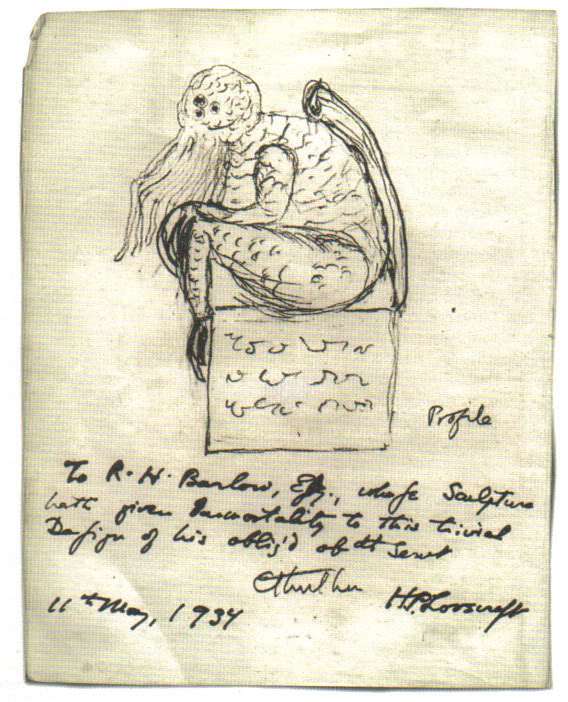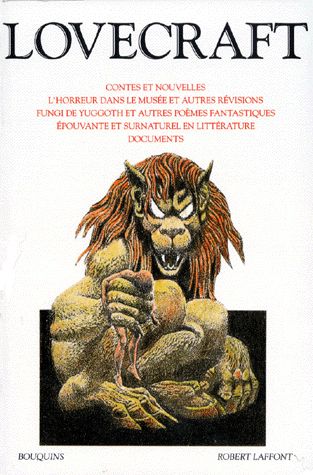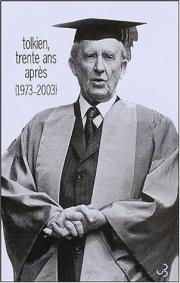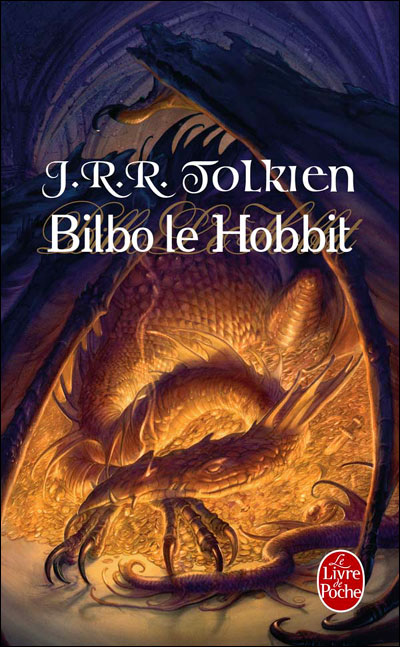Je vous propose ici de (re)lire l’article écrit pour le Bifrost spécial Lovecraft sur l’appel de Cthulhu, la nouvelle. J’en livre ici une analyse de passionné, dans le seul but de vous convaincre de relire Lovecraft !
—
Introduction et description
Démons
et merveilles[1], voici
ce que m’apporte la lecture de Lovecraft.
Démons
et merveilles liés, la découverte d’un mal immense, absurde, s’accompagnant de
visions et de sensations extraordinaires. Les récits du « mythe » ne
me terrorisent pas, ils provoquent chez moi, quand ils sont réussis, ce
sentiment que les anglais appellent awe, la terreur stupéfaite de Moïse au
Sinaï, d’Elie entendant passer Dieu silencieux comme un souffle. Un
émerveillement cosmique.
J’ai
lu trop jeune l’appel de Cthulhu, je
voulais de la terreur, et comprendre pourquoi les joueurs de jeu de rôle
faisaient tout un foin de cet auteur. Le récit m’a paru froid et
ennuyeux ; heureusement, j’y suis revenu plus tard, et j’y ai trouvé des
trésors. Je voudrais dans ce petit article proposer une lecture admirative et
technique d’un des textes les plus fameux du gentleman de Providence.
Rappelons-en
le propos et l’organisation : après un paragraphe introductif brillant, très
souvent cité[2], nous
lisons les notes de Francis Wayland Thurston, de Boston, qui reprend et
complète les travaux de son oncle défunt, le professeur Angell. Celui-ci
rapporte les rêves étranges vécus en mars 1925 par un sculpteur, Henry A.
Wilcox, qu’il rapproche d’autres rêves survenus à des personnes
« sensibles » dans le monde. Grondements, cités sous-marines, paroles
mystérieuses : Cthulhu ftaghn !.
Dans une seconde partie, on comprend l’intérêt suscité par les rêves de Wilcox
chez Angell en découvrant le témoignage datant de 1908 de l’inspecteur Legrasse
qui, à la nouvelle Orléans, a démonté un culte « sataniste » adorant
le même fameux Cthulhu. Thurston se
passionne alors en anthropologue pour ce culte dont il analyse les croyances à
travers le témoignage d’un prisonnier de Legrasse. Puis, à travers un article
de journal, il remonte au récit d’un capitaine norvégien ayant vécu la plus
terrifiante des aventures dans le pacifique en ce fameux moi de Mars 1925. La
distance intellectuelle cède peu à peu place à la terreur, comme Thurston se
rend compte que les croyances folles des adeptes des Grands Anciens pourraient
être basées sur des faits et que toutes les personnes ayant fait ses
recoupements où ayant été confrontées à ces faits sont mortes dans des
circonstances mystérieuses. Thurston sait que ce sera alors bientôt son tour et
le lecteur comprend que le sien, de tour, viendra aussi.
Structure du récit
Comment
souvent chez Lovecraft, le récit est construit par un motif en spirale,
approchant de plus en plus près une vision livrée dans la toute fin du texte.
Partant d’un point de vue rationnel (Thurston et Angell sont tous deux des
scientifiques) on aborde les faits les plus étranges de manière dépassionnée,
par un jeu d’allers retours entre les faits et leur remise en question,
jusqu’au déchirement final de l’horizon du témoin.
L’appel a ceci de particulier que la
vision est double : en premier, la révélation faite à Legrasse (et,
indirectement, à Angell) de l’existence d’un culte mondial, archaïque, révérant
des puissances « venues des étoiles » endormies depuis le début de
l’humanité. N’est pas mort qui a jamais
dort… Les étranges statuettes, les corrélations entre les témoignages
construisent cette révélation terrifiante. Seconde vision : la cité surgie
du fond de l’océan, aux formes impossibles, ruisselante de vase, où s’éveille
un géant dont on ne peut dire ni la substance
ni la taille.
Comment
faire croire le temps d’un récit à de telles incongruités ? L’art narratif
de Lovecraft est de savamment fusionner ses créations avec le réel. Il nous abreuve
de factuel pour nous faire accepter ses rêves. L’appel est avant tout un
dossier, une pile de papiers rassemblés par deux scientifiques successifs,
Angell puis Thurston ; en suivant le texte nous avons l’impression de lire
des pages et des pages de pattes de mouches, de coupures de journaux, de
rapports de police, de témoignages. Les éléments matériels mentionnés par le
récit sont nombreux. Sous nos yeux, nous avons :
- Un « étrange bas-relief d’argile », un objet bizarre sculpté par Wilcox
- Des notes, « sans aucune prétention littéraire », sous le titre Culte de Cthulhu, divisées en deux parties :
- 1925 – Rêves et œuvres d’Après-Rêves d’H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island
- Notes sur le récit des rêves reçus par les correspondants du Dr. Angell
- Coupures de presses sur des troubles survenus partout dans le monde.
- Récit de l’inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle Orléans, Louisiane. Notes à propos de ce dernier et la relation du Prof. Webb.
- Une statuette de pierre, grotesque, repoussante, et apparemment très ancienne.
- La même statuette, rapportée par Johansen
- Le Sydney Bulletin du 18 avril 1925
- Le manuscrit de Johansen, en anglais, censé traiter de « questions techniques ».
Le
lecteur est un enquêteur, qui, à la suite de Thurston, lit et interprète des
témoignages. Aucune vérité ne lui est imposée, à lui de croire où non ce qu’on
lui dit, à lui de se référer à ces éléments factuels que le récit égrène :
dates, coupures de journaux, personnes réelles dont l’adresse est fournie. Aucun
chantage affectif, aucun pathos, aucune embrouille dans le récit lovecraftien,
d’où sa réelle froideur. Ce style détaché, cette apparente objectivité, la
référence permanente au rationalisme de Thurston, tout ancre le lecteur dans la
posture d’un chercheur à qui on donne peu à peu les pièces d’un puzzle
halluciné.
Habilement,
Lovecraft ne cite presque jamais le verbatim des articles de journaux ou des
témoignages. Le filtre de la synthèse effectuée par Angell puis Thurston permet
de maintenir le rythme du récit, de faire émerger les points saillants des
documents et éléments du dossier. Et par ce canal rationnel, il nous emmène de
plus en plus loin dans le rêve.
Compréhension
L’univers
du récit me paraît structuré en trois cercles : le cercle de la
raison : les Blancs éduqués de la Nouvelle Angleterre, les hommes des
sociétés savantes, les compte-rendu de journaux ou de police ; le cercle des
croyances : domaine des Noirs, des squatters, des Inuits ou des Blancs peu
éduqués. De ce cercle proviennent rumeurs, délires, folies, sujettes évidemment
à caution. Puis le cercle des inspirations et de la folie, celui des Dieux
endormis, des espaces sous-marins et du Necronomicon. C’est ce dernier cercle
que nous sommes venus contempler et que l’on va nous offrir, à travers de
nombreux intermédiaires.
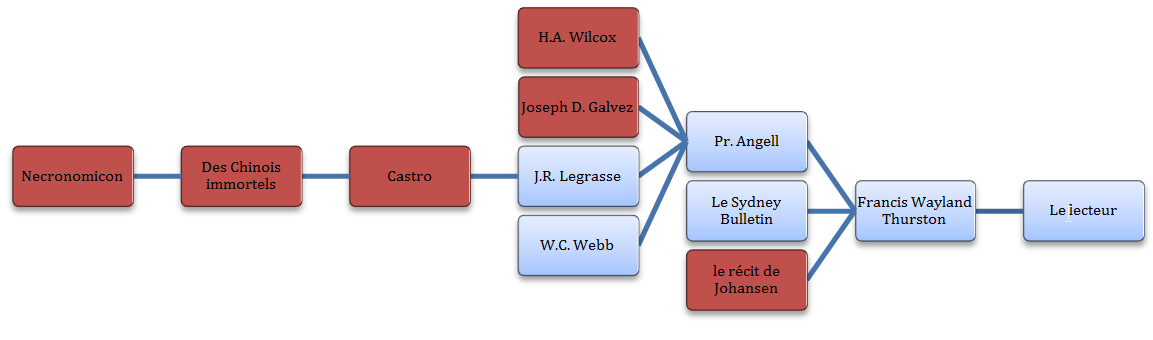
La
folie nous apparaît ainsi à travers de nombreux filtres. Jamais Thurston ne
pose les yeux sur le Necronomicon : une citation de ce dernier nous
parvient à travers Thurston, lisant Angell, interviewant Legrasse, interrogeant
Castro, lui-même suivant l’enseignement d’ « immortels chinois »
lui rapportant le contenu du fameux livre ! Pas moins de 7 intermédiaires,
donc, entre le tome maudit et le lecteur, qui dit mieux ?
Comment percevons-nous d’ailleurs le monde lointain, sinon à travers des rapports, des
lectures et des témoignages indirects ?
D’autant
que l’espace imaginaire créé par Lovecraft ne souffre d’aucune des faiblesses
congénitales à ce genre de choses : il n’a rien d’anthropocentrique, toutes
les tentatives de le délimiter et de le définir se heurtent aux limites de la
perception et de la compréhension : quelle est la taille des Grands Anciens ? Et la matérialité du grand Cthulhu
lui-même ? La précision de la description des statuettes ne fait que
souligner le flou (plein de conditionnels) sur la nature réelle des Anciens :
d’où viennent-ils ? Dorment-ils ? Peut-on vraiment croire un cultiste
qui s’est fait tabasser dans les prisons de la Nouvelle Orléans par l’inspecteur
Legrasse ? Le nom Cthulhu lui-même a été arrangé pour être imprononçable,
approximatif, pour qu’apparaisse évidente son origine étrangère.
Je
trouve deux limites à la construction imaginaire lovecraftienne : la
vision très datée et raciste opposant Blancs-civilisés-raisonnables aux
Etrangers (Noirs, Inuits…)–rêveurs–sauvages. Et un petit détail : il est
peu probable qu’un scientifique ait avoué ne pas pouvoir du tout identifier la
pierre des statuettes, il aurait au moins proposé une hypothèse[3].
Des
adorateurs, de la manière dont s’organisent ces cultes archaïques, on ne sait
rien, et à partir de ce qu’il ignore, le lecteur peut enflammer son
imagination. Projeter ses propres hypothèses, ses fantasmes. S’appuyant sur une
réalité totalement crédible, Lovecraft nous laisse ainsi entrevoir et peupler de
nos fantasmes un monde flou, imprécis, immense et terrifiant. Démons et
merveilles.
[1] Le
recueil paru chez 10/18 autour des récits du Contrées du rêve s’intitulait
ainsi. Ce titre semble être un pur choix éditorial français.
[2] Ce qu’il y a de plus pitoyable au monde,
c’est, je crois, l’incapacité de l’esprit humain à relier tout ce qu’il renferme.
Nous vivons sur une île placide d’ignorance… (traduction Claude Gilbert)
[3] Par exemple : « une forme très rare de stéatite précambrienne ».