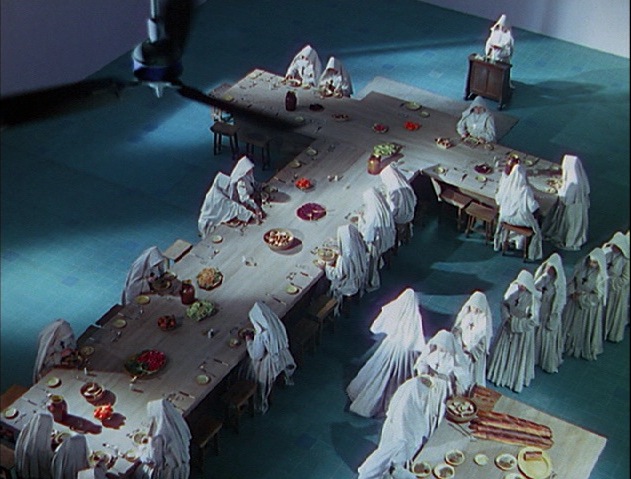Suite de notre exploration de l’univers foutraque de Wes Anderson.
Fantastic Mr Fox est un film d’animation adapté d’un roman très marrant de Roal
Dahl dont il respecte grosso-modo la trame. Mais les personnages parlent comme
des personnages de Wes Anderson, comme des adultes avec des problèmes d’adultes
(tu es sûr que c’est le moment d’acheter ? Est-ce qu’on va avoir un
deuxième enfant ?), on y trouve un ado mal dans sa peau, des minorités en
mal d’intégration et un paquet de trucs bizarres.
Le film a beaucoup de charme mais dégage l’impression d’un truc bancal, pas
vraiment pour enfants (nos filles n’ont pas accroché, peut-être étaient-elles
trop petites ?), balançant entre la frénésie narrative et la comédie de
dialogues. Quelques scènes, toutefois, sont magnifiques (la rencontre avec
Canis lupus, notamment) et le personnage de Fox est très réussi.