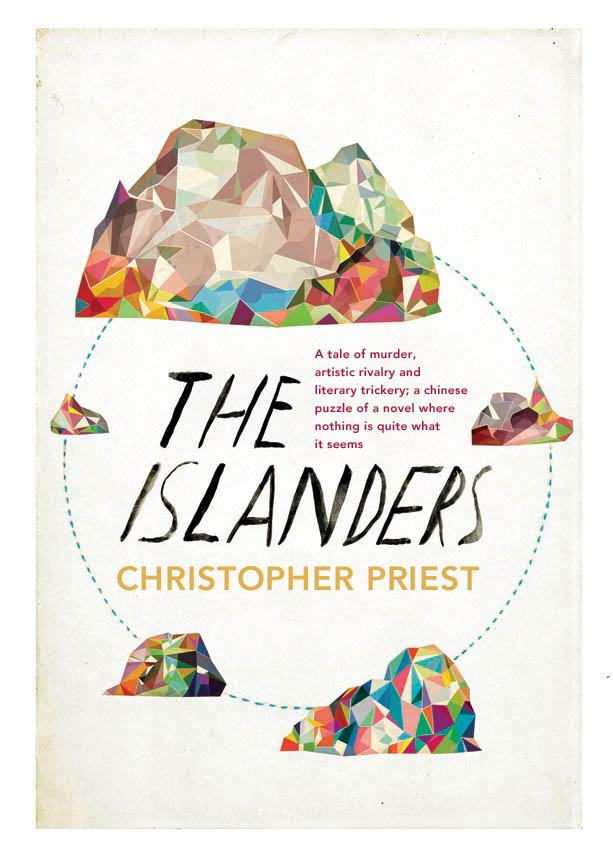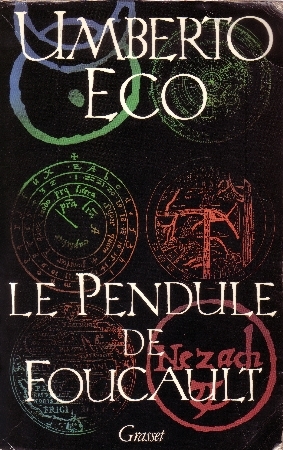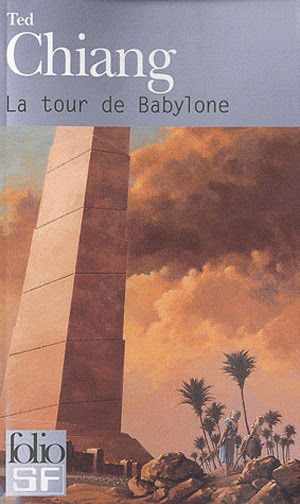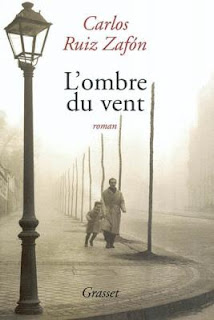Je suis venu à ce livre, séduit par ce qu’en disait l’auteur sur son blog. A la fois beaucoup et presque rien. L’enfance, des collégiens enfermés dans un lieu étrange, écho du Silling de Sade, lieu des supplices des 120 journées de Sodome… Jours réglés mécaniquement, contraintes, imagerie cruelle. Alors oui, il y a bien un peu de Sade dans le livre. Moins que je ne croyais. C’est, en vérité, tout à fait différent.
Je suis venu à ce livre, séduit par ce qu’en disait l’auteur sur son blog. A la fois beaucoup et presque rien. L’enfance, des collégiens enfermés dans un lieu étrange, écho du Silling de Sade, lieu des supplices des 120 journées de Sodome… Jours réglés mécaniquement, contraintes, imagerie cruelle. Alors oui, il y a bien un peu de Sade dans le livre. Moins que je ne croyais. C’est, en vérité, tout à fait différent.
Au tout début de 120 journées il y a donc ces huit collégiens. Disparus, enlevés, jetés avec des adultes plus ou moins méchants mais bizarrement intentionnés dans un non-lieu de béton, de canalisations qui fuient, de bruits qui résonnent. Cent vingt journées, pas une de plus, pas une de moins, un chapitre par jour, chronique parfois brève, humoristique, cruelle, précise, du temps passé en détention. Quatre fois trente jours (ça a son importance). Et tous les dix jours, les récits du conteur, dont on suivra plus ou moins la vie en compagnie de sa Ninon, sa crapote, sa fille, qu’il aime.
Ce n’est pas un roman agréable, même si sa lecture coule facilement. Rien n’est clair, les propos et les buts sont obscurs, des vagues d’ennui le recouvrent parfois. Mais j’ai été un collégien, j’aurais pu faire partie des reclus de Silling. Je me suis reconnu dans leurs hésitations, leurs attentes, leur indifférence, leur mollesse. Encore un peu enfants, un peu autre chose. Dans le roman on rit, on s’effraie, on ressent de vagues malaises, on ne parvient pas à mettre le doigt sur certaines sensations qui sont bien là. J’aurais envie de recopier les premières pages, celles de l’arrivée au collège, qui parlent des perpendiculaires et des parallèles, des trainaillements, du portail, du pont, des maisons de la pisse, des cartables. J’aurais aimé réussir à les écrire moi-même, j’ai voulu pouvoir décrire cela, parce qu’il y a là une forme d’exploit. Mettre des mots sur le confus, l’indicible, le quotidien. Toucher juste. Les grands livres sont ceux qui nous révèlent le monde.
A travers ses contes et ses demi-cauchemars, par la déformation et l’imaginaire, Jérôme Noirez parvient à toucher ce qui se cache en vérité derrière des mots que l’on croit connaître. Collégiens. Adolescents. Enfants.
120 journées, quatre mois de trente jours/quatre années de collège, qui avale des enfants aux petites corps et recrache des pré-adultes mal dégrossis. Quatre années de règles absurdes, d’apprentissages incompréhensibles, de leçons de violence et de cruauté. Silling est le collège et Silling est autre chose, un projet pédagogique absurde, parfait. Je voudrais lui mettre pour devise les mots d’Elisandre. Pour bien faire, il faut crever.
120 journées fait partie de ces romans particuliers, qui déforment le monde. En levant les yeux du livre, le décor autour de moi se teintait de ces formes indistinctes peuplant le livre, comme les ombres dans le monde la princesse-limnée. Les brumes sont venues sur la montagne, ce qu’on croit tenir ferme s’évade sous nos doigts. Je laisse le livre là. Mais lui ne me laisse pas.