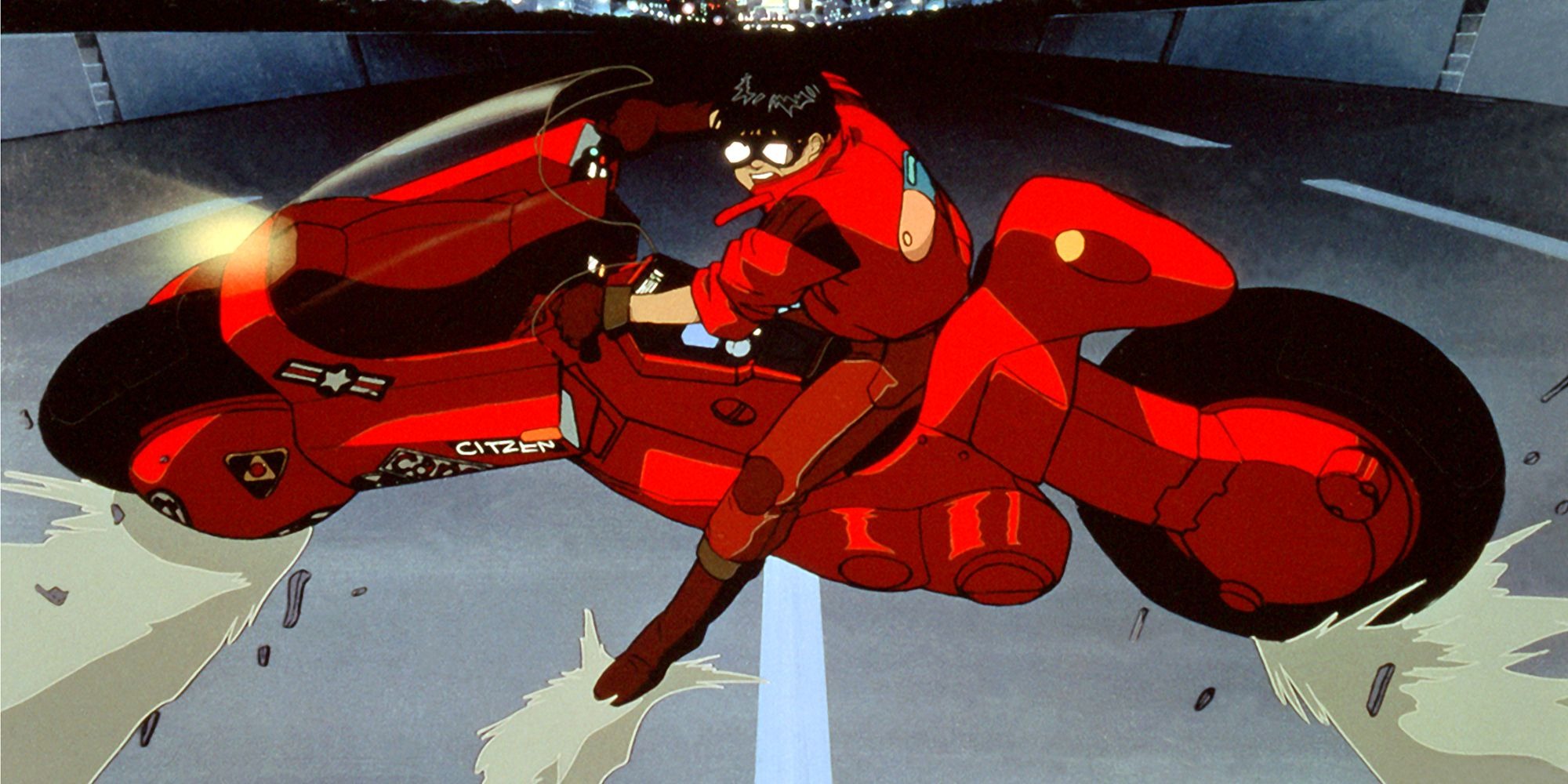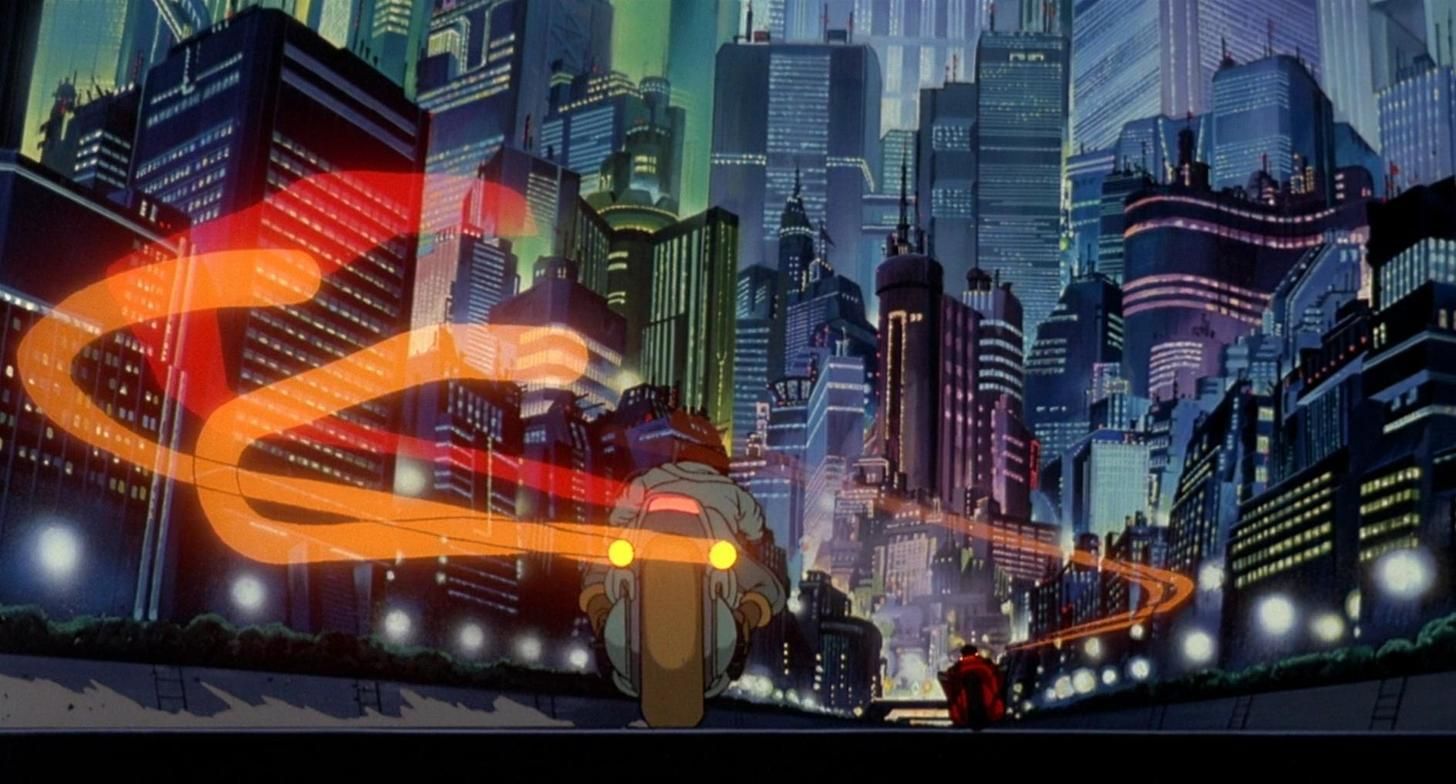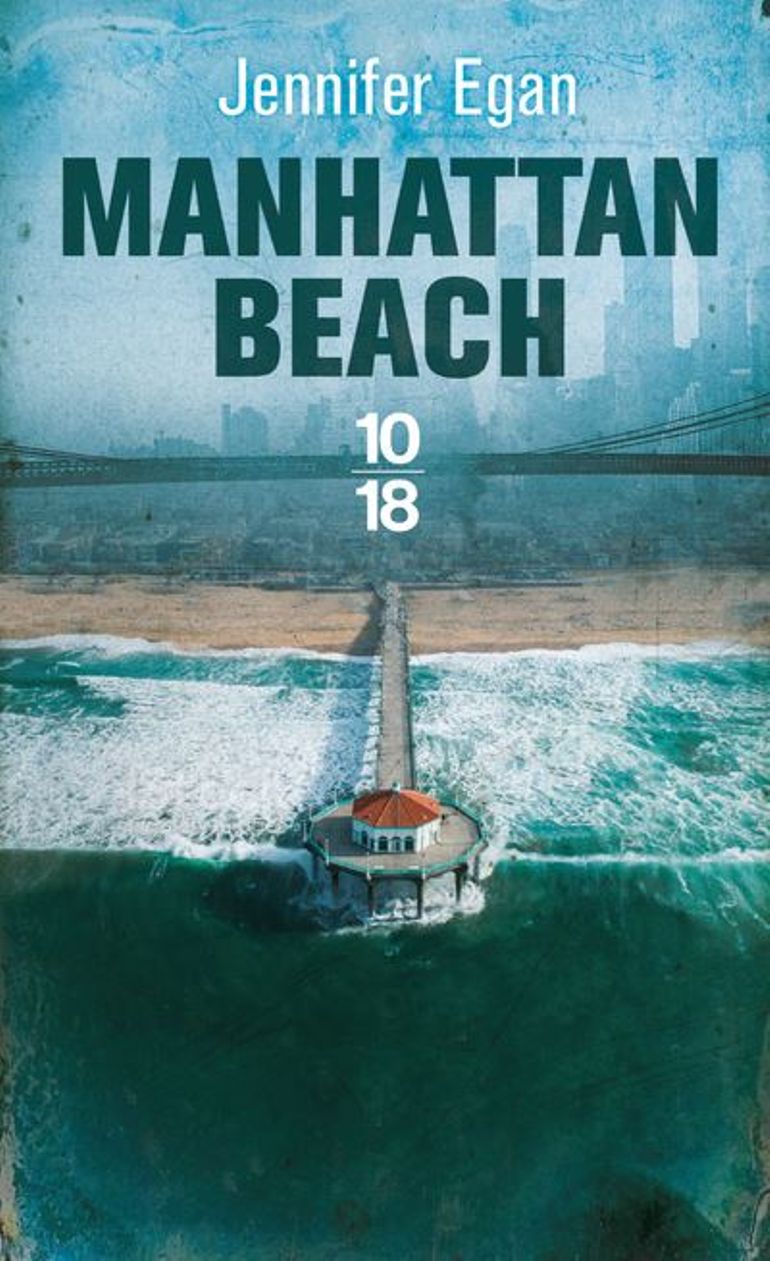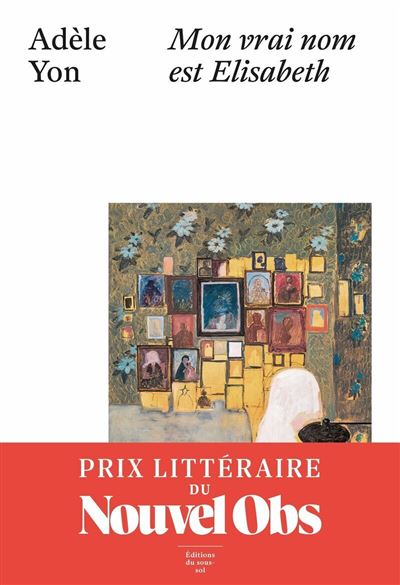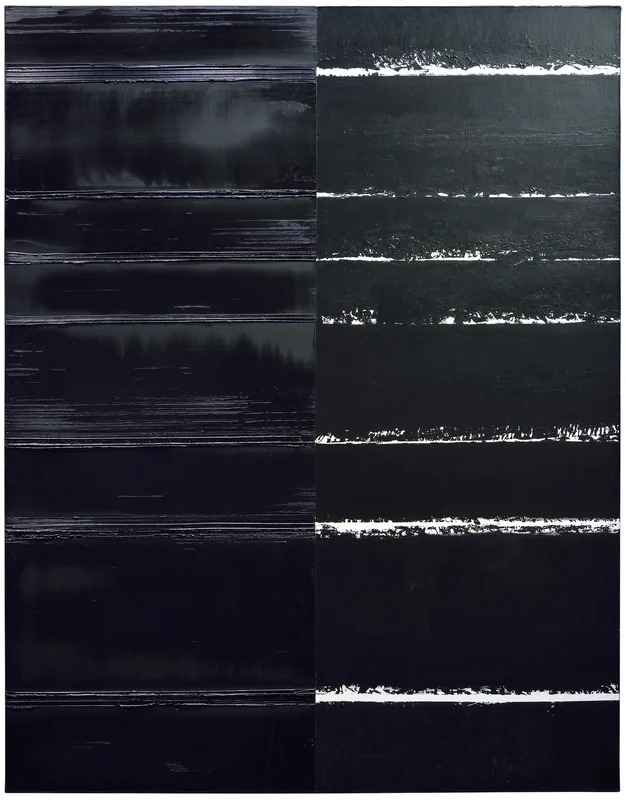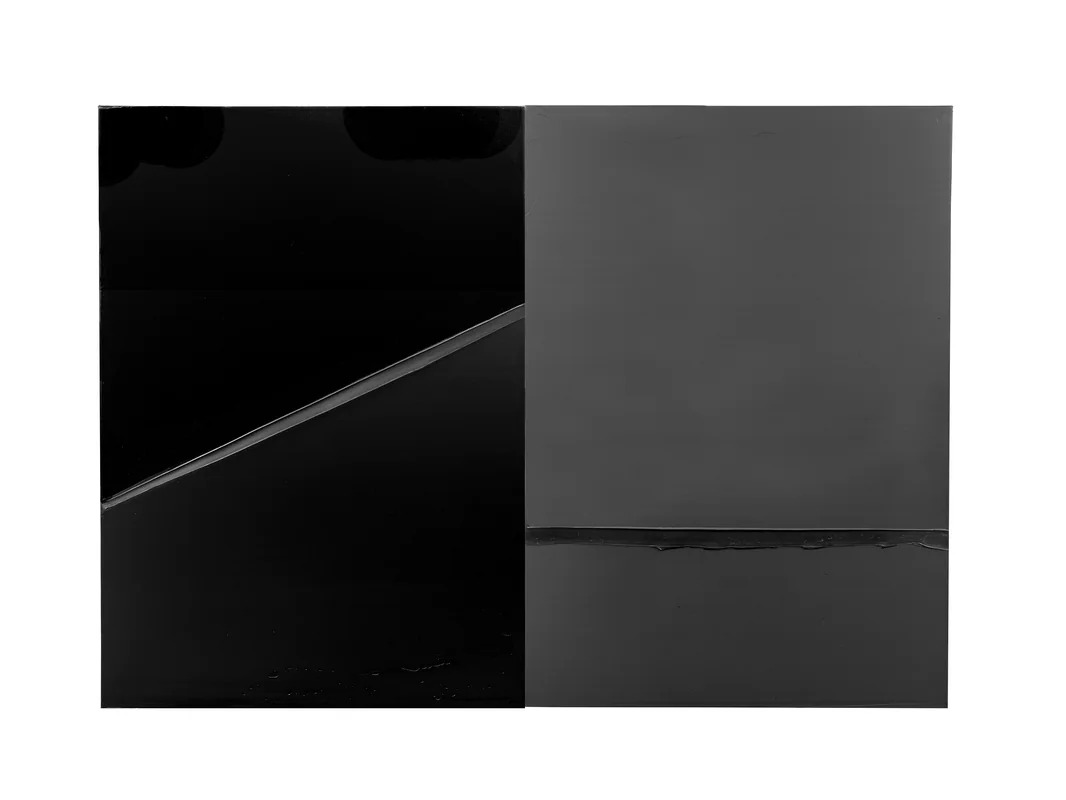Claude est une chômeuse en fin de droits qui n’a pas grand-chose pour elle, excepté son petit studio. Qu’elle perd bicose, we said, « fin de droits », you know ? (c’est un peu comme le début de Vernon Subutex).
Alors quand elle reçoit une offre d’emploi chelou via LinkedIn qui l’invite à séjourner dans une improbable location AirBnB pendant quelques semaines contre rétribution, elle ne fait pas la difficile et voilà go, elle est partie dans un coin perdu de France, et la location est une grande maison vraiment confite dans le passé et bien… elle est hantée. Et même carrément TRES hantée.
Dans ce petit roman (sa densité et sa brièveté sont une de ses nombreuses qualité), Catherine Dufour explore le genre du « roman de maison hantée » dans la France des années 2020, avec réseaux sociaux, minimas sociaux et workings poors qui dorment dans leur voiture. Et c’est vraiment très bien. Il y a des idées tout le temps, du suspense, des retournements de situations, des personnages secondaires douteux et moins douteux, une héroïne tétue (qualité de pauvre) et ni très jolie ni très sympathique, à la destinée de laquelle on s’attache. On comtpe les euros, on vide le bénitier de l’église d’Iliouville, on observe le prix des vieux meubles et des petits objets sur e-bay… Le passé suinte, et colle, et mord, glacial. On se demande ce que sont devenus les domestiques et qui peut bien faire le ménage dans la maison aux fantômes. Bref, c’est rigolo, pertinent et malin. L’autrice se permet même de nous livrer, quelques trucs sur sa méthode de travail. Et tout ça ne serait rien sans le style à la fois tendre et caustique de Catherine (oui, disclaimer, je la connais et je l’aime bien – mais cette chronique est garantie sans copinage).
D’une curieuse façon, ce livre court est un cousin de la trilogie-des-genres de Léo Henry (Le casse du continuum, la panse, Thécel). Ce n’est pas un « grand roman », ça ne veut pas l’être, c’est juste distrayant, intelligent et très bien écrit. Et assez souvent, ça fait peur.