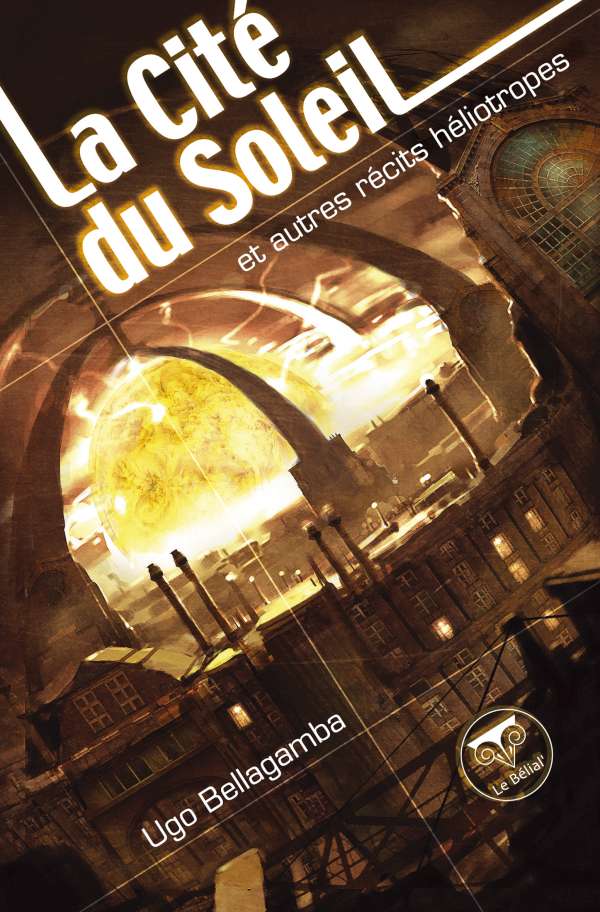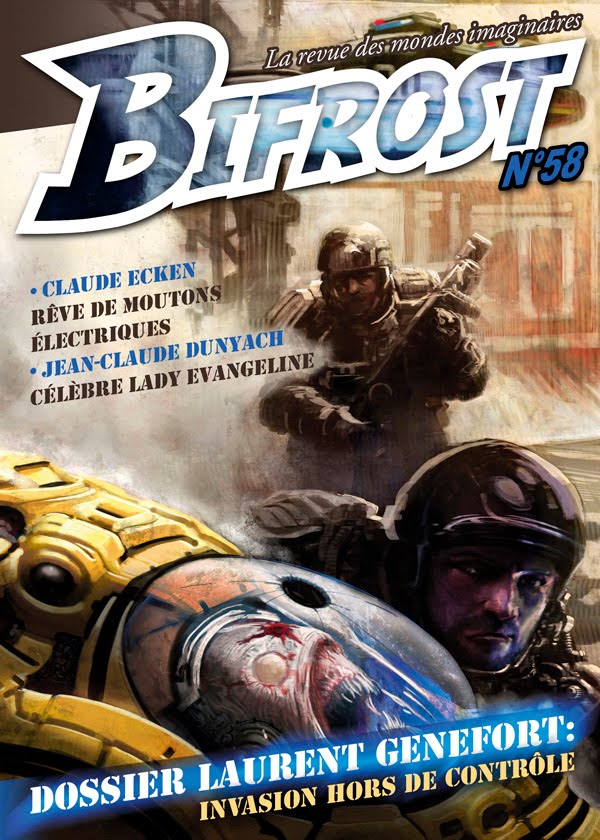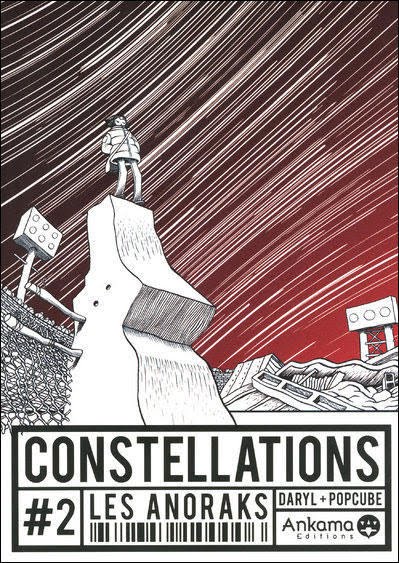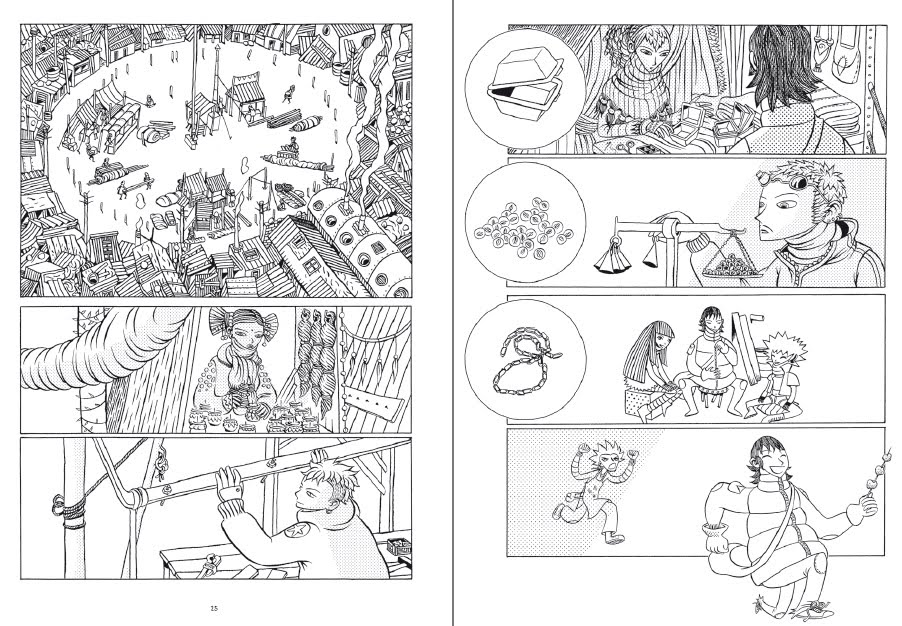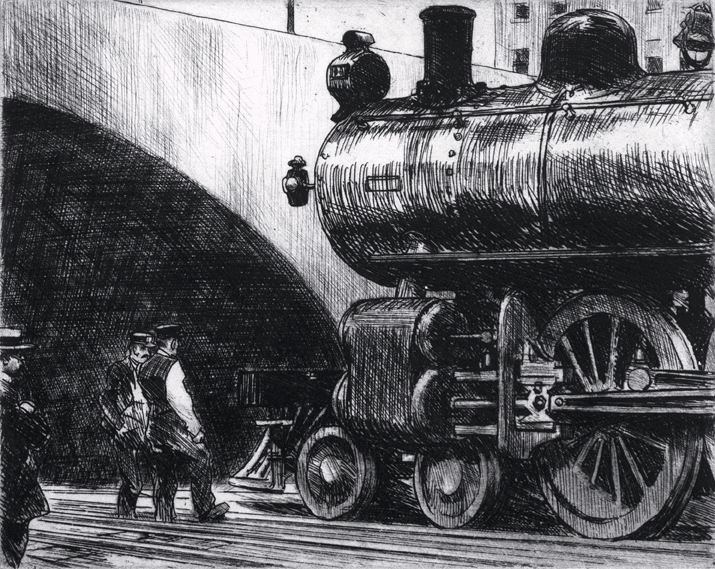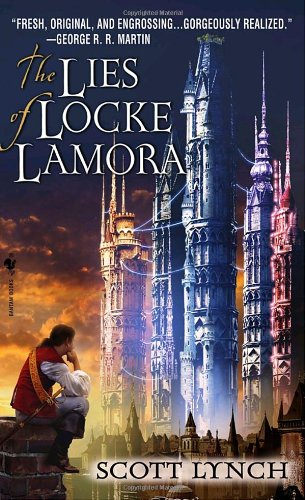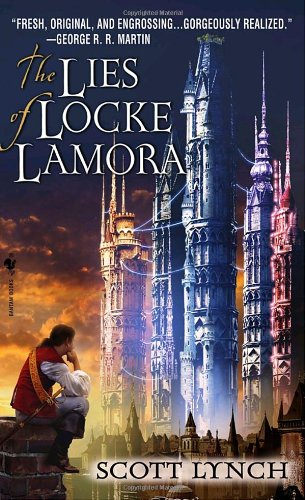
Parlons un peu de mes lectures de plage.
Surmontant mes préjugés envers la fantasy de supermarché (culturel), je suis parti en vacances avec deux livres que leur réputation avait amené dans ma pile à lire. Le premier d’entre eux, The Lies of Locke Lamora, fera l’objet de cette note. Tout comme les corbeaux de-chez-Smith-d’en-face, j’avais été séduit par le thème, la jolie couverture de Benjamin Carré (l’édition américaine dont je dispose est par contre proprement hideuse) et la description enthousiaste qu’en faisait l’éditeur. Je ne le cache pas, j’aime bien les histoires de voleurs. En fait, non : j’aime Lankhmar et les aventures de Fafhrd et du Souricier Gris.
Dans The Lies…, on suit les aventures d’une bande d’audacieux gaillards, les Gentlemen Bastards, menés par Locke Lamora, petit type aux talents de déguisement proprement déments, Jean Tannen, costaud amateur de hachettes et de littérature, les frères Sanza, tricheurs aux cartes et Bug, apprenti de la bande. Ces joyeux lurons amateurs de bonne chère déambulent dans la cité-Etat de Camorr, qui doit ses canaux à Venise, son nom et ses moeurs à Naples (j’imagine que l’assonance Camorr / Camorra n’est pas fortuite).
Le début du livre est très prometteur : par le jeu d’une narration très amusante, on apprend la petite enfance du jeune Locke, ses très grosses bêtises, son incroyable astuce, dans un échange de discussions plein d’humour avec Father Chains, le maître et initiateur de notre héros. J’ai beaucoup apprécié. Et j’ai lu le livre avec un grand plaisir jusqu’à la page 100 environ (comme tout bon pavé, il fait un peu plus de 600 pages). Les cinq cents pages suivantes m’ont fait : bailler d’ennui, trépigner d’agacement, crier contre des héros et des méchants aussi bêtes, et, au final, réfléchir sur ce sujet : pourquoi les joueurs et maîtres de jeu de jeu de rôle ne devraient pas (jamais) écrire de roman. (attention, petits spoilers)
- Ils n’ont jamais peur du cliché : pourquoi un bon scénario de jeu de rôle fait-il en général un piètre roman ? Parce que dans un scénario, les joueurs pardonneront tous les clichés, toutes les situations vues mille fois, parce que ce sont eux les héros, parce ce que c’est leur aventure. Dans The Lies… on a : une histoire de vengeance-parce-que-tou-as-toué-mon-père-tou-va-mourire (avec la voix d’Inigo Montoya), un Mystérieux Chef des Services Secrets du Vatican, un Vieux Maître Bourru Mais Plein de Sagesse, un Grand Méchant Méchant (la tenue, et la manière de parler, et tout), une bombe qui menace le président des Etats-Unis (si, si, là je me suis tapé la tête sur le mur pour y croire, les lecteurs comprendront). Les personnages secondaires sont quasiment tous ratés, ils sont là pour remplir des rôles mais ils n’ont aucune épaisseur humaine. Pas trop grave, ce sont des PNJs.
- Ils ont le syndrome du gros bill : je ne pense pas tellement à Locke et ses copains, qui sont très forts mais bon, on ne va pas leur reprocher, mais plutôt au Mago 27, vous savez, celui de Mongol et Gotha (pas trouvé de référence sur le web pour ce merveilleux strip…). Et bien oui, il est là, il vole, il lit dans les pensées, il fait se tordre les gens dans d’atroces souffrances et il a un look issu d’un comic book de super-héros). Il ne fait pas peur, non plus. J’ajoute à ça l’effet Dragon Ball de l’histoire : le super-chef-de-la-pègre est bluffé par les super-super-voleurs-de-la-mort, qui affrontent les super-super-super-services-secrets qu’ils sont tous trop forts, tous coiffés au poteau par le super-super-super (etc) méchant et le mago 27.
- Ils adorent rédiger des suppléments de background : Camorr est un décor assez réussi : l’Elderglass, les ponts, la profusion des populations, les docks, les cinq grandes tours, le Echo Hole, la Floating Grave où siège le roi des voleurs… J’ai malheureusement eu très souvent l’impression de lire : Camorr, the campaign setting. Les fréquentes interruptions de récit pour me présenter le pourquoi de ceci ou cela, la vérité sur tel ou tel décor… sont contraires à tout sens du bon goût. Ca intéressera, voire ça passionnera le MJ mais ça n’intéresse pas le lecteur qui aimerait lire un roman. Par ailleurs, Lynch a une conception toute rôliste de la religion. Donc son polythéisme ressemble à l’habituel ramassis de cliché de tout monde de JdR et n’offre aucun intérêt et n’a aucune crédibilité.
- Ils ont l’esprit de système : et ça, c’est affreux. Dans ce roman, tout effet a une cause, tout ressort psychologique s’explique, toute scène a un précédent. Si Locke se comporte comme il le fait, c’est parce que, et parce que… et si Jean est bon à la bagarre, c’est parce que et parce que. Et si Father Chains (bon perso, bien gâché) enseigne comme il le fait, c’est parce que et parce que.
Je ne met pas dans cette liste les incohérences débiles du récit : Locke est un super concepteur de plans géniaux et le méchant passe son temps à le surprendre, il n’est pas capable d’essayer de devenir ce qu’il va faire (moi, je l’avais fait). Barsavi est un super parrain de la pègre très balaise et il n’est pas capable de comprendre comment on massacre ses hommes (il ne pense pas loin, le pauvre type). The Spider est un super chef des services secrets, qui n’a pas un seul garde du corps pour veiller sur lui. (méga spoiler ici : les Bondsmages sont tellement balaises qu’ils n’ont jamais envisagé que quelqu’un puisse vouloir estropier l’un des leurs). Je ne parle même pas des Gentlemen Bastards capables d’accumuler une somme folle en or pendant des années sans avoir aucune idée de ce qu’ils peuvent en faire. Et des magiciens capables d’abattre des empires mais qui demandent de l’or pour leurs faux-frais. Aberrant.
Et tout ça est bien dommage parce que le récit comprend quelques (très) bons moments : l’arnaque au Floating Market pendant que des prisonniers se font déchiqueter par des requins, l’assaut des Midnighters sur la maison du Don (j’ai bien aimé l’effet « envers du décor ») et la longue scène où Locke, désespéré, doit se procurer des vêtements. J’aurais bien aimé aimer ce livre, mais il a bien trop de défauts pour moi.
Si vous avez aimé ce bouquin, n’hésitez pas à me dire que je ne sais pas lire, c’est sans doute le cas. Et je suis bien conscient que les remarques ci-dessus ne sont pas valables si on se dit qu’un livre comme The Lies… vise surtout à distraire, à s’amuser, à « ne pas se prendre la tête ». Mais si c’est là son seul but, il ne m’intéresse pas.
PS : je n’avais pas vu le commentaire de Munin en rédigeant ce post. Il remplacerait avantageusement mon billet. (le tout dernier du billet, à l’heure où j’écris)